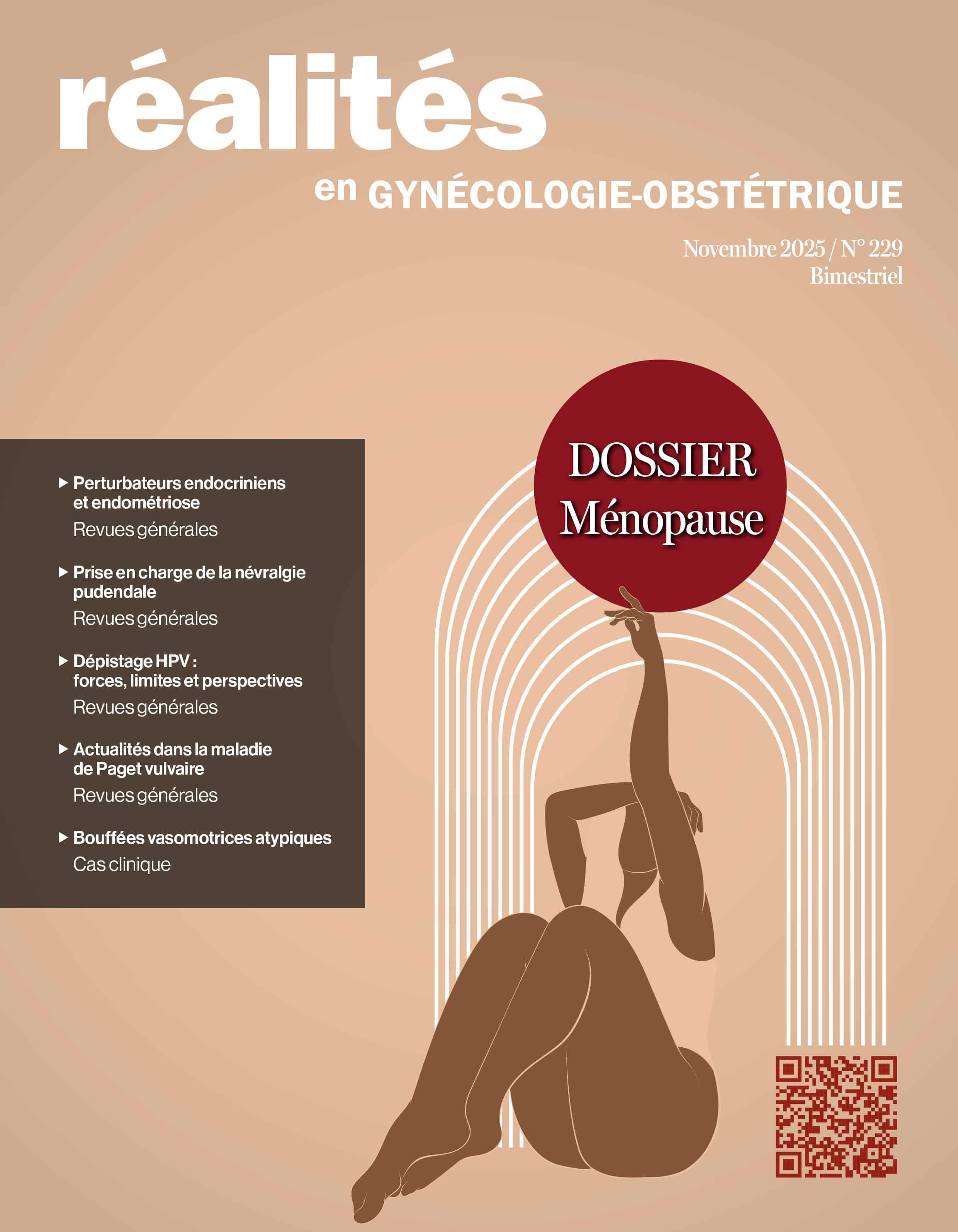La photobiomodulation : intérêt dans la sécheresse vaginale, les dyspareunies et les douleurs pelviennes
La photobiomodulation (PBM) est une technique de soins qui s’est beaucoup développée depuis quelques dizaines d’années, particulièrement en dermatologie et en ORL. Ses effets sont connus depuis très longtemps et plusieurs milliers de publications scientifiques les ont prouvés et partiellement expliqués. On peut dire que la PBM est, pour la cellule animale, ce qu’est la photosynthèse aux cellules végétales.
Le transfert d’énergie lumineuse en énergie biologique induit des effets cliniques prouvés sur la cicatrisation, la douleur et l’inflammation. Le transfert des connaissances obtenues en dermatologie et en ORL a permis, grâce aux similitudes histologiques, de mettre en place des protocoles de soins très souvent efficaces et toujours sans danger. Il est certain que nous manquons de protocoles précis et d’études rationnelles. Il est certain aussi que si l’aspect empirique déroute notre esprit scientifique, l’expérience quotidienne nous réconforte. L’absence de caractère dommageable ou préjudiciable, le caractère strictement indolore des procédures, la simplicité de leur mise en œuvre incitent à une utilisation quotidienne en tant qu’adjuvant à nos thérapeutiques habituelles. C’est ainsi que la PBM est un procédé qui trouve sa place à la frontière de nos échecs.
En effet, la PBM permet de prendre en charge et d’aider de nombreuses patientes pour lesquelles l’allopathie traditionnelle a montré ses limites en particulier en cas de sécheresse vaginale, de dyspareunie et de douleurs pelviennes.

Quels compléments alimentaires pendant la grossesse ?
Les compléments alimentaires (CA) – dont le but est de compléter le régime normal – sont commercialisés sous différentes formes galéniques associant plusieurs micronutriments (vitamines, minéraux) qui ont un intérêt théorique au cours de la grossesse. En pratique, une alimentation standard, suffisante et diversifiée suffit à couvrir les besoins nutritionnels de la grossesse. Les CA ont pour objectif de renforcer les apports spécifiques en micronutriments, notamment le fer, les folates, le calcium, la vitamine D, l’iode et bien d’autres encore. La démonstration de leur intérêt n’a pas été établie concernant une amélioration du statut fœto-maternel dans des conditions normales. En revanche, ils ont un intérêt dans certains contextes particuliers, comme les pratiques alimentaires particulières (végétarisme, végétalisme, restriction volontaire), la fragilité socio-économique, les grossesses multiples et, peut-être, le risque de prééclampsie. En l’occurrence, les croyances s’imposent bien souvent à la science à en juger par l’engouement pour les CA.

Diabète gestationnel et chirurgie bariatrique
La prévalence de l’obésité est en constante augmentation et la chirurgie bariatrique est, à l’heure actuelle, la thérapeutique la plus efficace. Elle est réalisée dans près de la moitié des cas chez des femmes en âge de procréer. Malgré la perte de poids, ces femmes restent exposées, pendant la grossesse, à un risque élevé de diabète gestationnel, quel que soit le type de chirurgie effectué. En parallèle, une évaluation carentielle doit être pratiquée avant la grossesse ou, au plus tard, en tout début de grossesse. Le dépistage de diabète gestationnel doit donc être fait de façon systématique (pour tout IMC) selon différents procédés à différents termes de la grossesse : une glycémie à jeun et une HbA1c au premier trimestre, une HGPO au deuxième trimestre sauf chirurgie de bypass gastrique. La prise en charge reste classique, elle repose essentiellement sur les mesures glycémiques et la mise en place d’une insulinothérapie peut s’avérer nécessaire.

Le Plan national fertilité
Le Plan de lutte contre l’infertilité, annoncé le 16 janvier 2024 par le Président Macron, doit être prêt en juin 2024. Il s’appuiera sur le rapport Hamamah-Berlioux. L’âge féminin moyen de la première grossesse, en France, est passé de 27,8 ans en 2000 à 28,8 ans en 2019 ; et l’âge moyen pour avoir un enfant est de 30,8 ans pour une femme et de 33,1 ans pour un homme (en 2020). Dans le rapport Hamamah-Berlioux sur les causes d’infertilité, publié en février 2022, les axes retenus sont l’éducation collective et individuelle, la formation des professionnels de santé à la prévention de l’infertilité, et au diagnostic des causes, la mise en place d’une recherche coordonnée via un programme (et équipements prioritaires) de recherche (PEPR) Santé des femmes, santé des couples dédié à la recherche sur l’infertilité et l’endométriose, et, enfin, la création d’un Institut national de la fertilité. L’ambition est forte, la tâche immense, la concrétisation de ce plan sera liée aux résultats obtenus.

Psoriasis et grossesse : paroles de patientes
Parvenir à une solution thérapeutique satisfaisante et surmonter les diverses appréhensions intimes et affectives dues à la détérioration de l’image de soi dans cette maladie affichante sont deux facteurs déterminants pour envisager la vie sexuelle que l’on désire. Et tout naturellement vient le désir d’enfant. Mais une grossesse ne va-t-elle pas venir remettre en question les résultats obtenus après une bataille parfois longue et difficile contre le psoriasis ? De plus, la question de la transmission de la maladie et de la santé de l’enfant ainsi que celle du déroulement de la grossesse et de l’allaitement se posent, dans un contexte d’informations sans guidance, concernant les traitements et leur compatibilité avec la santé de la mère et de l’enfant…

La cryolipolyse : mythes et réalités
La cryolipolyse est une technique qui nous est proposée depuis 2009 ; elle n’est donc pas récente, mais elle fait toujours aujourd’hui l’objet de nombreuses discussions, voire de critiques, parfois justifiées, parfois non. Il s’agit pourtant d’une technique “bien née”, initiée par Rox Anderson, (le développeur des lasers à colorant pulsés, des lasers épilatoires, des lasers Q Switched, des lasers fractionnés et du principe général de la photothermolyse spécifique). Elle bénéficie de nombreuses études de réelle qualité qui démontrent tant son efficacité que sa bonne tolérance, du moins en ce qui concerne l’appareil de référence, le CoolSculpting. Aujourd’hui, 14 années après ses débuts, nous pouvons faire une évaluation réaliste de son véritable intérêt.

Dépression du post-partum : où en est-on en 2024 ?
La dépression du post-partum est trop souvent sous-diagnostiquée, alors qu’elle représente, selon son mode de diagnostic et la période considérée, entre 10 et 20 % des accouchements. Il est donc fondamental de savoir la repérer chez la mère, chez le père, qui peut être aussi touché, en prenant en compte la qualité des interactions parents-bébé et les réactions de celui-ci.
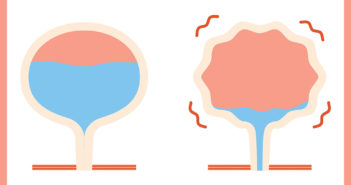
Urodynamique pour les nuls
L’exploration urodynamique ou bilan urodynamique (BUD) a bénéficié, ces dernières années, d’avancées significatives, tant dans la compréhension des dysfonctionnements du bas appareil urinaire qu’au niveau des équipements électroniques et de la standardisation de nouveaux tests. Cet article se veut essentiellement pratique en présentant les principes, les méthodes et les applications de l’urodynamique pour les protocoles. Une importante iconographie et les conseils cliniques vont faciliter la prise en charge des patientes.

Un dépistage des abus sexuels conduirait-il à moins d’hystérectomies ?
Les gynécologues sont des médecins de première ligne idéaux pour dépister les antécédents d’abus sexuels auprès de leurs patientes. En effet, les abus sexuels sont un problème de santé publique et sont associés à de nombreuses conséquences à long terme. Les patientes ayant survécu à de tels événements traumatisants ont plus de risque de surconsommer des soins de santé, ce qui peut amener à pratiquer des examens et des opérations chirurgicales peut-être inutiles. Un dépistage permettrait une meilleure prise en charge de ces patientes et probablement moins d’iatrogénie.

Prévenir les lombalgies et douleurs du bassin pendant la grossesse
50 à 75 % des femmes enceintes souffrent de lombalgie, qui reste pour autant un phénomène sous-estimé. Le risque de chronicisation des douleurs dépend des croyances de la patiente. La littérature ne fait pas état d’un “remède miracle” pour les éviter mais il existe de multiples moyens d’agir, en commençant par l’éducation thérapeutique aux bienfaits du mouvement et de l’exercice physique et enfin, par la réassurance.