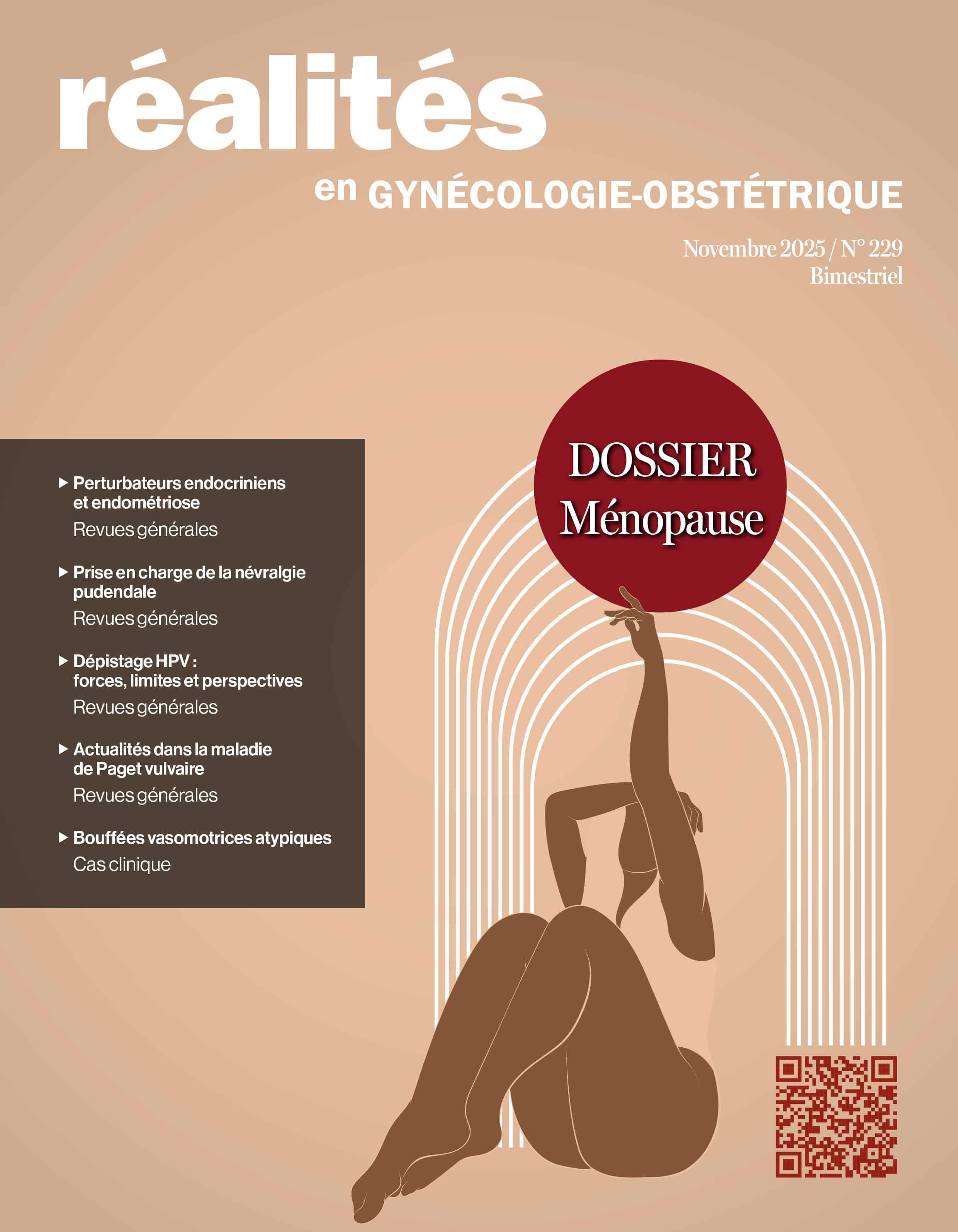Pemphigoïde gravidique : les clés du diagnostic et du traitement
La pemphigoïde gravidique est la dermatose bulleuse auto-immune spécifique de la grossesse. Elle est très rare (une grossesse sur 20 000 à 50 000 selon les séries). Elle touche préférentiellement les multi-pares, mais elle peut parfois (très rarement) se développer chez des primipares. Dans la série de Jenkins et al. [1], les premiers symptômes débutentau 1er trimestre dans 18 % des cas, au 2e trimestre dans 34 % des cas, au3e trimestre dans 34 % des cas, et dans le post-partum dans 14 % des cas.

Apport de la robotique en chirurgie pelvienne bénigne
La robotique en chirurgie pelvienne bénigne est actuellement en début d’évaluation mais également en plein essor. Elle est utilisée dans les hystérectomies pour pathologie bénigne, la chirurgie de l’infertilité et celle du prolapsus principalement.
La chirurgie robotique permet de diminuer les pertes sanguines et la durée d’hospitalisation pour toutes les interventions en chirurgie pelvienne bénigne, mais au prix d’une durée opératoire plus longue et d’un coût global plus important. Il n’y a pas de différences en termes de complications pour la plupart des interventions. L’apport de la vision en trois dimensions, d’une dextérité et d’une précision, permet une dissection minutieuse dans la chirurgie tubaire en particulier.
La chirurgie robotique est un apport qui peut être précieux, mais qui reste d’un coût élevé.

Le devoir d’information en gynécologie-obstétrique
L’accouchement est un acte naturel, qui ne constitue pas un acte médical nécessitant des informations spécifiques, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence [1].
Cependant, dès le stade préconceptionnel et tout au long du processus de grossesse, l’obstétricien est tenu de délivrer à la femme enceinte une information claire, loyale et adaptée sur son état, sur l’accouchement et ses risques, compte tenu de sa situation. Toutefois, la grossesse pouvant devenir rapidement pathologique, le devoir d’information est indispensable.
Ce n’est qu’en cas d’urgence ou d’impossibilité d’informer personnellement la patiente que le médecin est dispensé de cette obligation légalement sanctionnée.

Quand et à qui proposer un diagnostic préimplantatoire ?
Le diagnostic préimplantatoire (DPI) consiste en l’analyse génétique d’une ou deux cellules embryonnaires (blastomères) prélevées sur des embryons âgés de 3 à 5 jours, issus de la fécondation in vitro. Ce diagnostic est réservé à des couples ayant un risque identifié de transmettre une maladie génétique ou chromosomique grave et incurable. C’est une alternative aux techniques classiques de diagnostic prénatal (prélèvement de villosités choriales, amniocentèse).
Le DPI offre aux couples à risque de transmettre une maladie génétique ou chromosomique d’une particulière gravité d’avoir un enfant indemne de cette maladie, et leur évite l’épreuve d’une interruption médicale de grossesse, puisque seuls les embryons sains sont transférés.

Choix de la première contraception
Proposer une contraception adéquate chez les adolescentes est primordial afin d’éviter toute grossesse non désirée. Il est indispensable de conseiller les jeunes filles de façon appropriée pour améliorer l’observance et leur expliquer les effets secondaires éventuels pour éviter les échecs de contraception.
Le risque d’infection sexuellement transmissible n’est pas négligeable, et il faut insister sur l’intérêt de l’usage du préservatif. La contraception combinée estroprogestative orale présente aussi des avantages non contraceptifs, comme l’amélioration de la dysménorrhée entre autres.
Le choix du contraceptif hormonal doit tenir compte des facteurs de risque personnels et familiaux, et il est nécessaire de reprogrammer une consultation ultérieure afin d’adapter la contraception si nécessaire.
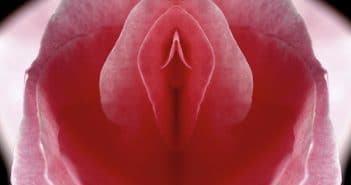
Les lésions dermatologiques de la vulve
Les principales causes de prurit diffus sont les candidoses chez la femme jeune et le lichen scléreux chez la femme plus âgée. Peuvent également être en cause : psoriasis, lichénification, lichen plan, dermites de contact, dermatite atopique. Nous discuterons dans cet article les lésions dermatologiques les plus fréquentes : lichen scléreux, psoriasis et lichen plan.
Une check-list précise, lors de l’interrogatoire et de l’examen clinique, permet une orientation diagnostique très avancée. Un avis dermatologique et/ou une biopsie sera pratiqué(e) devant toute forme clinique atypique ou résistante à un traitement bien conduit. Il est toujours prudent d’éliminer une candidose par un prélèvement local avant d’instituer le traitement qui repose pour ces trois dermatoses sur l’application de dermocorticoïdes, de manière très prolongée pour les lichens.

Le lichen scléreux (LS) vulvaire
Les formes familiales représentent 12 % des cas de LS. Il semble que le risque carcinologique soit alors plus élevé : 4,1 % vs 1,2 % [1]. Le risque de pathologie thyroïdienne est augmenté en cas de LS : les chiffres varient de 16 à 18 % selon les études, alors que la fréquence est de 8 % chez les contrôles. La présence d’anticorps antiperoxydase et/ou thyroglobuline a été dépistée dans 22 % des cas et une thyroïdite de Hashimoto constatée à l’échographie dans 19 % des cas [2].

L’impact des troubles respiratoires du sommeil maternels sur le développement neurologique de l’enfant à naître
La grossesse est liée à de nombreux changements physio-logiques et notamment sur le sommeil. Ces changements apparaissent surtout au 3e trimestre où on peut voir se -développer des troubles respiratoires du sommeil. Il a été décrit dans la littérature une corrélation entre les troubles respiratoires du sommeil et l’apparition de pathologies -gravidiques comme l’HTA, la prééclampsie, le diabète, le RCIU, la prématurité et un accouchement par césarienne et un Apgar bas à la naissance. Mais ces résultats ne sont basés que sur une évaluation subjective des troubles respiratoires du sommeil. Le but de cette étude est de déterminer à partir de tests médicaux les objectifs et l’impact des troubles respiratoires du sommeil sur le devenir neurodéveloppemental néonatal et de l’enfant à 1 an.

Être végétalien ou végétarien pendant la grossesse, est-ce dangereux ou la panacée ?
Les régimes végétalien ou végétarien (VV) sont de plus en plus répandus dans le monde occidental, et reflètent le choix des femmes à avoir une alimentation réfléchie. Toutefois, cette étude à effectuer une revue de la littérature pour en savoir plus sur les bénéfices/risques de cette alimentation pendant la grossesse et surtout chez les patientes présentant des -pathologies particulières.

Quel avenir pour le diagnostic prénatal ?
Le formidable essor des techniques de diagnostic prénatal a permis sans cesse des progrès depuis les années 80, dans la qualité du dépistage et du diagnostic des malformations congénitales et des maladies du fœtus. De nouvelles techniques ont régulièrement supplanté les anciennes, considérées plus risquées, avec des résultats toujours plus rapides, plus fiables, plus complets.
Actuellement, des nouvelles techniques sont développées pour la médecine fœtale : hybridation in situ, hybridation comparative et hybridation génomique, d’une part, et l’arrivée depuis quelques années du dépistage non invasif de la trisomie 21 dans le sang maternel, d’autre part.
Ces nouvelles techniques non seulement modifient le paysage de la médecine fœtale, mais préfigurent déjà les possibilités diagnostiques qui seront à notre disposition dans la quinzaine d’années, soulevant dans le même temps de nouveaux problèmes éthiques dans la réflexion autour de la médecine fœtale.