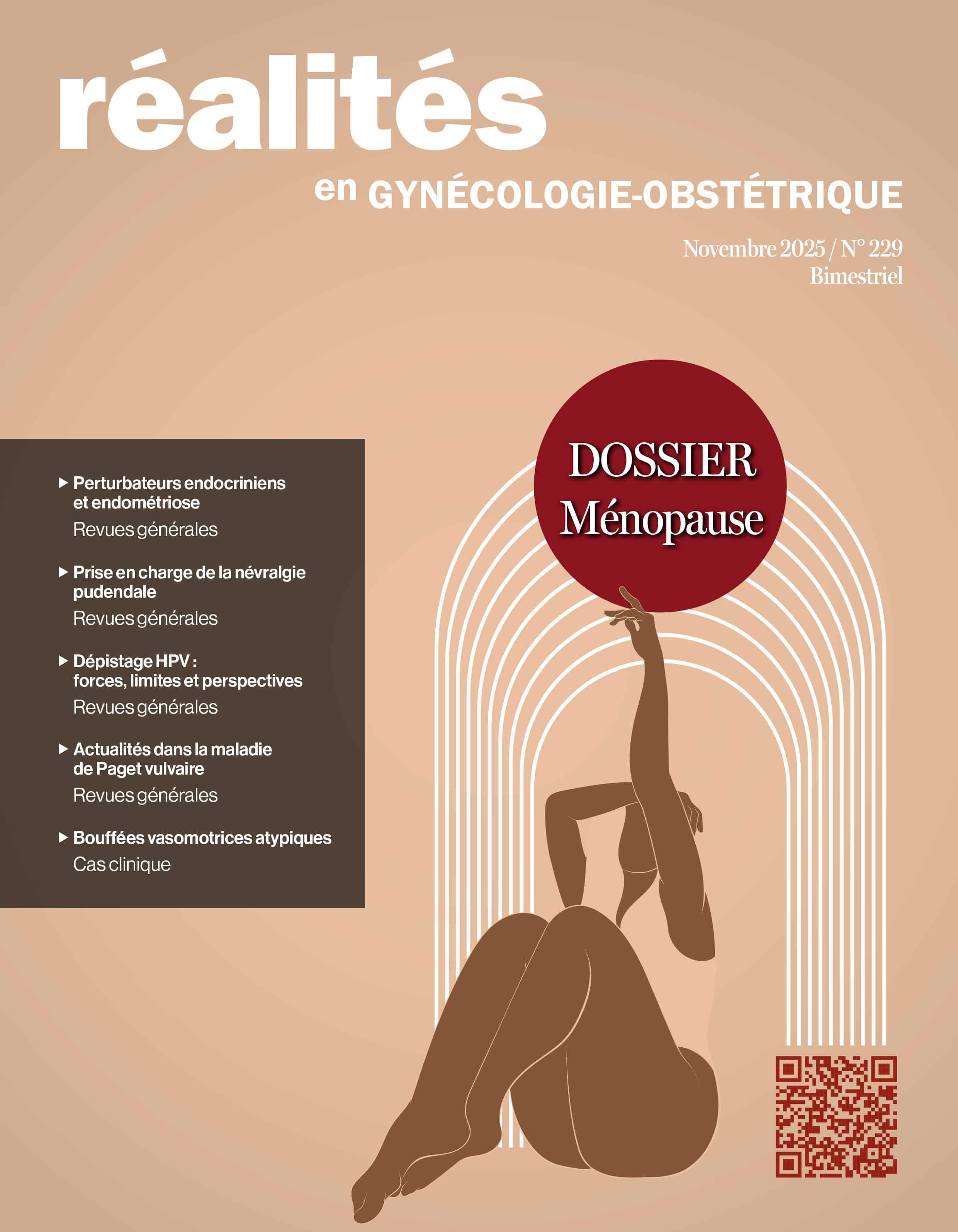Anorexie mentale et infertilité : quelle prise en charge ?
La fertilité est largement influencée par le poids et le statut nutritionnel. La prise en charge de l’infertilité des femmes en anorexie mentale ou avec des troubles du comportement alimentaire ne s’envisage qu’après le retour à un poids proche de la normale.
Si dans les formes sévères, le désir d’enfant est rarement présent à la phase aiguë de la maladie, il ne faut pas méconnaître des formes latentes qui devront être recherchées systématiquement à l’interrogatoire devant toute femme de petit poids consultant pour des troubles de l’ovulation.
Si la prise en charge pluridisciplinaire des troubles du comportement alimentaire ne permet pas le rétablissement d’une ovulation normale, le traitement de l’anovulation par pompe à GnRH donne d’excellents résultats. L’évaluation préalable de la réserve ovarienne permet de moduler la posologie de départ et de réduire le risque de réponse inadéquate. Le pronostic obstétrical de la grossesse ainsi obtenue peut être altéré si le poids de départ ou la prise de poids pendant la grossesse est insuffisante.

La chronobiologie : la nouvelle science du vivant
Les rythmes circadiens montrent universellement une oscillation de 24 heures dans les fonctions métaboliques, physiologiques et comportementales de presque toutes les espèces.
Ce schéma est dû à une adaptation fondamentale à la rotation de la Terre autour de son axe. Mais il est maintenant clair que nous sommes sous le contrôle d’un ensemble de gènes appelés les gènes de l’horloge.
Le stimulateur central est sous le contrôle de la lumière, mais d’autres stimulateurs existent en fonction du temps d’alimentation et de la consommation de nutriments et des neurones à orexine qui coordonnent la dépense énergétique, le sommeil et la gratification.
La désynchronisation de cette rythmicité semble être impliquée dans de nombreuses pathologies, y compris la tumorigenèse et la progression du cancer.

L’entretien postnatal précoce : une évidence ?!
Le Plan périnatalité de 2005-2007 nous engage à assurer la sécurité émotionnelle des parents par une “approche plus humaine, de proximité” pendant toute la période périnatale.
Après la mise en place de l’entretien prénatal précoce (EPP), mesure phare de ce plan, et dans la continuité de celui-ci, il convient de proposer aux parents avec leur bébé un entretien postnatal précoce (EPNP) qui réponde aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS. Pour satisfaire aux besoins des parents, souvent en grand désarroi lors du retour à domicile, cet entretien, semi-directif, vise à maintenir la continuité et la cohérence du suivi périnatal. Il s’agit d’écouter de façon active et bienveillante le vécu et les attentes parentales pour “repérer avec” eux leurs compétences et leurs vulnérabilités.
La proposition d’un accompagnement personnalisé, inscrit dans la dynamique de réseau, permettra de consolider leur “parentalité naissante” et d’œuvrer pour une prévention primaire d’éventuels troubles périnataux.

Stimulation ovarienne : quoi de neuf ?
En fécondation in vitro, les effets délétères de la stimulation ovarienne sur l’endomètre sont connus, ainsi que le risque de survenue d’un syndrome d’hyperstimulation ovarienne. Il est vrai que les progrès de la cryobiologie ont récemment bouleversé les pratiques. Le bénéfice de la vitrification embryonnaire comparée à la congélation lente est démontré par de nombreuses études à tous les stades. Par ailleurs, les connaissances actuelles sont rassurantes en ce qui concerne les risques obstétricaux et néonataux après transfert d’embryons congelés.
Au vu de toutes ces données récentes, le choix de désynchroniser la stimulation ovarienne du transfert embryonnaire se répand et les indications s’élargissent. Ainsi, le choix du protocole antagoniste avec déclenchement de l’ovulation par agoniste de la GnRH est de plus en plus indiqué, afin de pouvoir congeler toute la cohorte embryonnaire et transférer les embryons sur un autre cycle. Les résultats en termes de taux d’implantation sont très prometteurs et cette pratique pourrait peut-être, à court ou moyen terme, concerner la quasi-totalité des patientes.

Progression de la myopie pendant la grossesse
Une modification de la réfraction peut être observée pendant la grossesse, avec en général une myopisation de moins de 1 dioptrie. Cette myopisation disparaît le plus souvent quelques semaines après l’accouchement.

Stéatose hépatique aiguë gravidique
La stéatose hépatique aiguë gravidique (SHAG) est une pathologie spécifique du 3e trimestre de la grossesse. Il s’agit d’une complication rare mais sévère. La mortalité maternelle et surtout fœtale reste élevée même si elle a drastiquement diminué ces dernières décennies.
La présentation clinique et biologique est assez évocatrice dans la forme classique, associant nausées, fatigue, potomanie et cytolyse hépatique, baisse du TP. Les diagnostics différentiels sont les hépatites virales aiguës, dont l’hépatite E, la prise excessive de paracétamol et surtout le syndrome HELLP. L’imagerie hépatique peut aider au diagnostic en mettant en évidence une stéatose hépatique.
Historiquement, le diagnostic positif reposait sur la biopsie hépatique avec la présence d’une stéatose microvésiculaire pathognomonique de la SHAG. Depuis les années 2000, les critères non invasifs de Swansea ont été validés. La présence d’au moins 6 critères sur les 14 permet de poser le diagnostic de SHAG. La prise en charge repose sur l’extraction fœtale rapide et sur une collaboration étroite entre réanimateurs, obstétriciens et hépatologues.
S’agissant de la physiopathologie de la SHAG, il a été mis en évidence une dysfonction mitochondriale portant sur l’oxydation des acides . Celle-ci serait responsable d’une accumulation intrahépatocytaire toxique des acides gras et d’une lipotoxicité se traduisant par une production de radicaux libres et un stress métabolique. Il en résulte une stéatose microvacuolaire aiguë dans les hépatocytes conduisant à l’insuffisance hépatique aiguë. Un dépistage génétique (gène HADHA) doit être proposé aux femmes ayant présenté une SHAG ainsi qu’aux nouveau-nés.

Découverte d’un cancer invasif du col utérin lors de la grossesse : que faire ?
Le cancer du col utérin (CCU) s’observe pendant la grossesse qui est de plus en plus tardive dans la vie de la femme (0,1 à 10/10 000 grossesses selon le niveau sanitaire des pays).
L’IRM est l’examen clé qui peut être effectué pour le diagnostic lésionnel et dans le cadre du suivi avant l’accouchement. Les curages ganglionnaires cœlioscopiques sont l’autre élément qui va permettre la discussion thérapeutique et restent possibles avant 24 semaines de grossesse (SG).
Les choix thérapeutiques sont complexes et font intervenir des paramètres cancérologiques obstétricaux et humains après une information loyale. Ils sont déterminés lors de réunions de concertation pluridisciplinaire et la tendance actuelle est de privilégier les options ménageant la fertilité ultérieure de la patiente.

Pathologies spécifiques des muqueuses génitales chez la femme : focus sur les dyspareunies superficielles
Les pathologies vulvaires sont une source fréquente de dyspareunie superficielle. Cela pose un double problème au dermatologue qui doit :
– faire le bon diagnostic dermatologique devant une patiente qui vient pour dyspareunie, ne pas considérer l’examen comme normal et résumer cette douleur à des causes psychologiques ;
– à l’inverse, savoir questionner une patiente initialement venue pour une pathologie vulvaire sur sa vie sexuelle et sur le retentissement de l’affection sur la qualité de ses rapports car de nombreuses patientes ne l’évoquent pas spontanément.
Le traitement étiologique constitue toujours la première ligne de la prise en charge, mais il est souvent rapidement nécessaire d’élargir les investigations et la prise en charge vers une orientation plus générale, de rechercher d’autres syndromes douloureux ainsi que des troubles psychologiques ou sexuels, et d’évoquer une vulvodynie associée.
Il est également important de connaître les bonnes indications de la kinésithérapie et de la chirurgie.

Rupture prématurée des membranes avant terme : peut-on envisager le retour à domicile ?
La rupture prématurée des membranes (RPM) avant terme est une complication fréquente de la grossesse responsable d’hospitalisations prolongées. La place de la prise en charge en hospitalisation à domicile (HAD) est discutée. Deux essais anciens randomisés ont montré une non-infériorité en termes de morbidité périnatale et maternelle.
Plusieurs études de cohorte ou de type avant/après semblent montrer un bénéfice de l’HAD, notamment au niveau de la durée de la période de latence, réduisant ainsi les complications liées à la prématurité. Il existe toutefois une grande hétérogénéité des critères d’éligibilité en fonction des centres. Il est néanmoins consensuel d’attendre au moins 48 heures en hospitalisation avant une sortie en HAD et de ne l’autoriser qu’en cas de stabilité clinique et d’absence de signes d’infection intra-utérine.

Dépression du post-partum : dépister avant tout !
La grossesse et le post-partum sont des périodes à risque de survenue d’un trouble psychique. On estime que 10 à 15 % des parturientes développent une dépression du post-partum (DPP). Les facteurs de risque les plus souvent retrouvés sont la primiparité, les antécédents personnels et familiaux de dépression et l’absence de soutien social perçu ou réel.
Les symptômes devant faire soupçonner le développement d’une DPP sont une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur, des plaintes somatiques dont l’asthénie, une labilité émotionnelle et une irritabilité, ainsi que tout trouble psycho-fonctionnel chez l’enfant. On peut évaluer ces symptômes avec l’Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).
On recommande un dépistage systématique de la DPP, puis une prise en charge transversale et intégrative. Dans certains cas, on peut également recourir à une hospitalisation conjointe en unité mère-enfant.