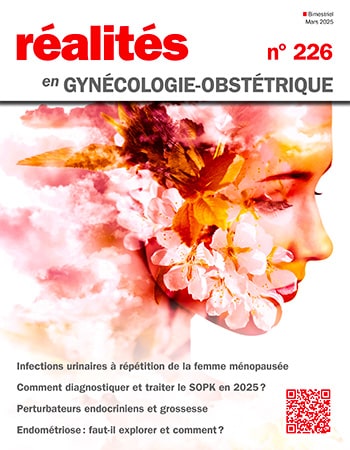Syndrome des antiphospholipides et grossesse
Le syndrome des antiphospholipides est une entité clinico-biologique pouvant être responsable d’une morbi-mortalité obstétricale (pertes fœtales précoces ou tardives, complications vasculaires, prématurité…). Le diagnostic repose sur l’association de critères cliniques et biologiques définis selon un consensus international. Les anticorps antiphospholipides ont également une valeur pronostique et la présence simultanée de plusieurs anticorps augmente le risque de complications obstétricales.
Le traitement repose sur l’association d’aspirine à dose antiagrégante et d’héparine de bas poids moléculaire dont la posologie dépend du caractère purement obstétrical ou thrombotique de la maladie. La prise en charge permet le plus souvent une évolution favorable de la grossesse. Cependant, de nombreuses situations restent complexes dans la démarche diagnostique ou la décision thérapeutique, et la prise en charge d’une grossesse chez une patiente porteuse d’un syndrome des antiphospholipides obstétrical requiert donc un suivi multidisciplinaire dans un centre spécialisé.