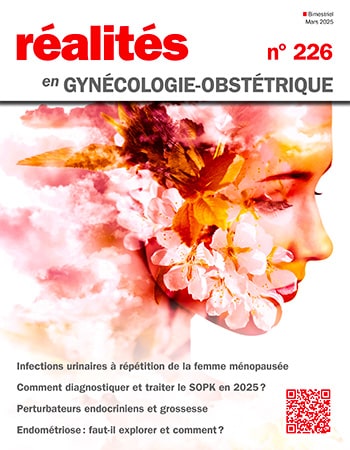Nausées et vomissements gravidiques en 2024. Enquête miroir auprès des patientes et des professionnels de santé
Les nausées et vomissements gravidiques sévères constituent la première cause d’hospitalisation au premier trimestre de la grossesse. Toutefois, ils ne sont pas systématiquement pris en charge. L’étude NAVIGA vise à évaluer par deux questionnaires distincts les pratiques de prise en soins des NVG par les professionnels de santé d’une part et le vécu par les patientes d’autre part. Les résultats montrent que 69 % des patientes souffrent de NVG, affectant leur qualité de vie (fatigue, inconfort vis-à-vis des odeurs, difficultés d’alimentation). Ces différents aspects de la qualité de vie sont considérés à leur juste valeur par les professionnels de santé, qui proposent une prise en soins quasi systématiquement à leurs patientes. Toutefois, celle-ci peut être optimisée et effectuée de manière plus précoce : seulement 20 % des répondants prennent en charge les NVG dès les signes avant-coureurs quand 65 % attendent l’apparition des premiers symptômes. L’étude NAVIGA souligne également la nécessité d’améliorer la prise en soins des NVG notamment en termes d’évaluation de la sévérité, mais aussi de connaissance des méthodes médicamenteuses et non médicamenteuses, d’information aux patientes et de comportement en consultation.