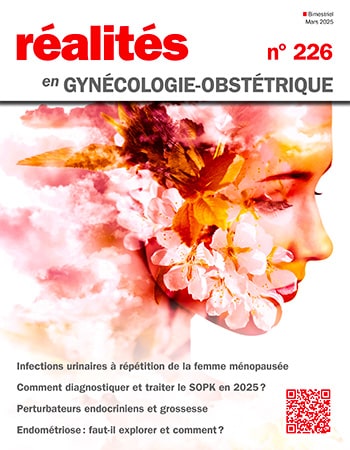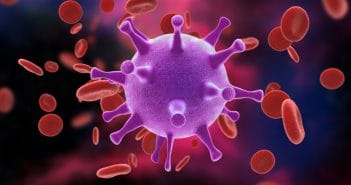Dépistage de la prééclampsie au 1er trimestre
L’intérêt d’un dépistage précoce de la prééclampsie, en fin de premier trimestre de grossesse, serait de proposer aux femmes à haut risque une surveillance adaptée de leur grossesse et des stratégies préventives (aspirine) pour diminuer l’incidence de la prééclampsie ainsi que la morbidité maternelle, fœtale et néonatale associée à la prééclampsie.
Ce type de politique de dépistage précoce ne doit pas s’assortir d’une augmentation de la consommation de soins, de risques iatrogènes, de coûts et d’impact psychologique, notamment chez les patientes considérées à risque mais ne développant pas de prééclampsie (faux positifs du dépistage). Or, la valeur prédictive positive des algorithmes de dépistage disponibles est faible et leur validité externe reste à démontrer sur la population française. Le test de dépistage précoce de la prééclampsie entre 11 et 14 semaines d’aménorrhée n’est donc pas recommandé à ce jour en population générale par le CNGOF.
Des études sont encore nécessaires pour valider une politique de dépistage précoce de la prééclampsie associée à une prévention par aspirine : c’est l’objectif de l’étude nationale RANSPRE.