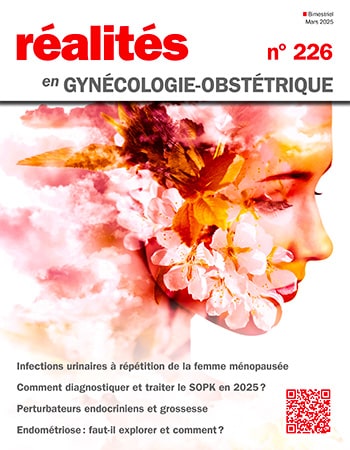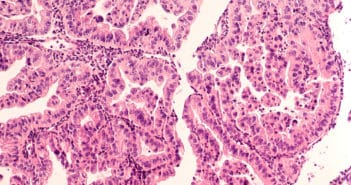Bouffées vasomotrices : quels traitements proposer ?
Les bouffées vasomotrices (BVM) représentent l’un des symptômes majeurs du syndrome climatérique, avec un impact sur la qualité de vie. L’estrogénothérapie en constitue le traitement le plus efficace. L’utilisation d’un traitement hormonal de la ménopause (THM) a fait l’objet de nombreuses controverses ces dernières années, notamment concernant les risques carcinologiques. Des recommandations des sociétés savantes ont été publiées récemment, permettant de guider le professionnel de santé. L’initiation d’un THM doit, au préalable, éliminer des contre-indications au traitement. Un suivi régulier évaluant la balance bénéfices-risques est nécessaire, avec une participation active de la patiente à son traitement et l’information sur les règles hygiéno-diététiques.