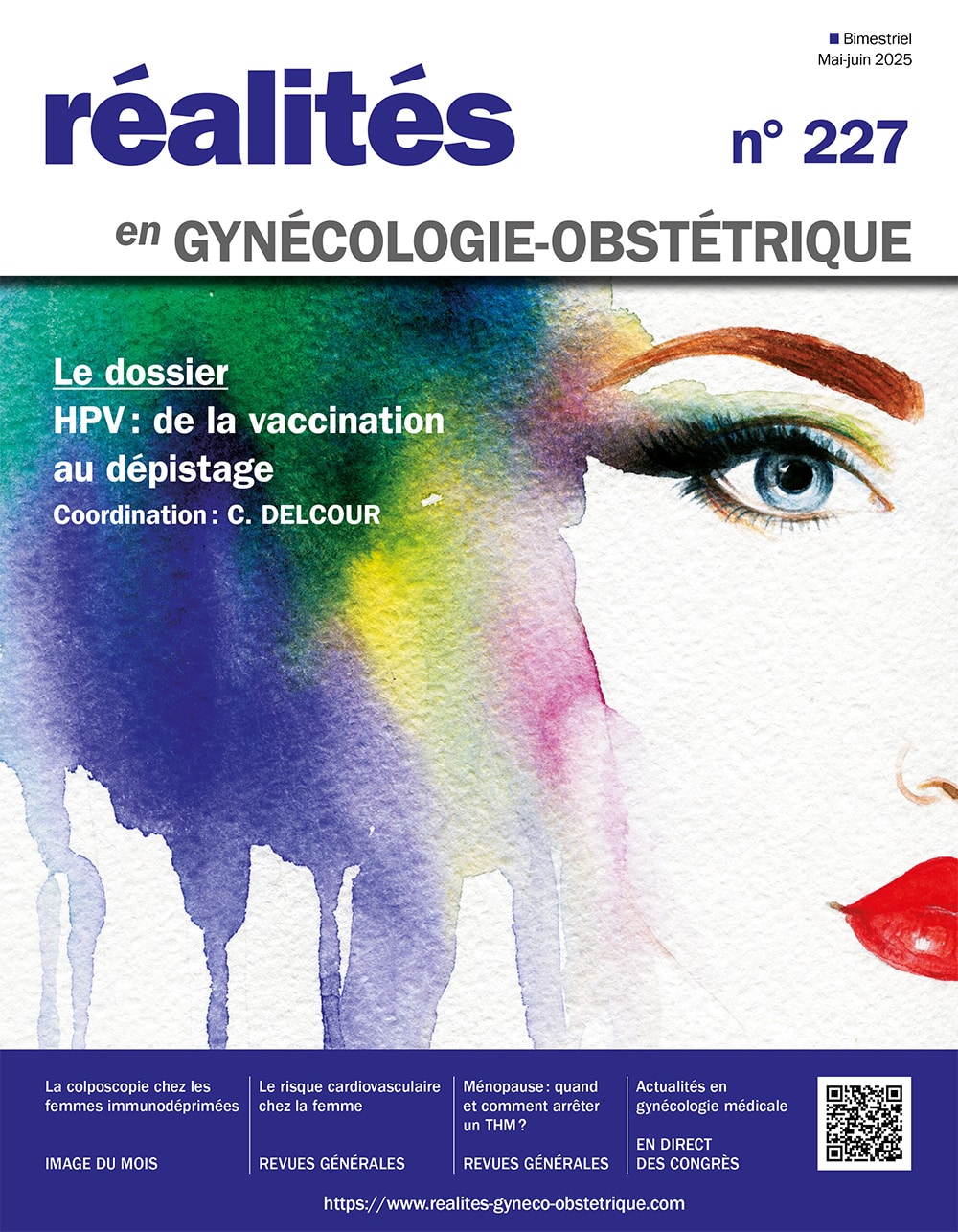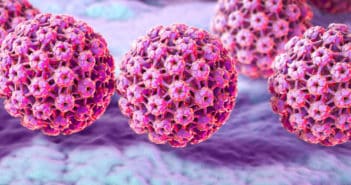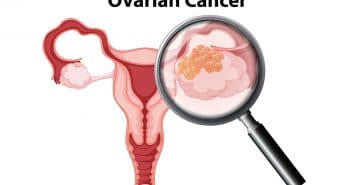Prise en charge des cancers du sein hormonodépendants
Les cancers du sein hormonodépendants représentent environ 75 % des cancers du sein. Leur diagnostic repose sur l’imagerie puis l’examen histopathologique avec analyse immunohistochimique. Le premier temps de traitement est chirurgical dans 85 % des cas et consiste dans 75 % des cas en un traitement conservateur associé à un geste axillaire, dans la majorité des cas une procédure du ganglion sentinelle. Après traitement conservateur, une radiothérapie adjuvante est indiquée. Les autres traitements adjuvants sont la chimiothérapie et l’hormonothérapie.
De nouveaux outils décisionnels permettent de personnaliser la prise en charge en limitant la prescription des traitements systémiques. Dès le diagnostic, une activité physique adaptée est fortement conseillée. Ces dernières années, l’apparition de nouvelles thérapies ciblées en situation métastatique a permis d’améliorer la survie sans progression.