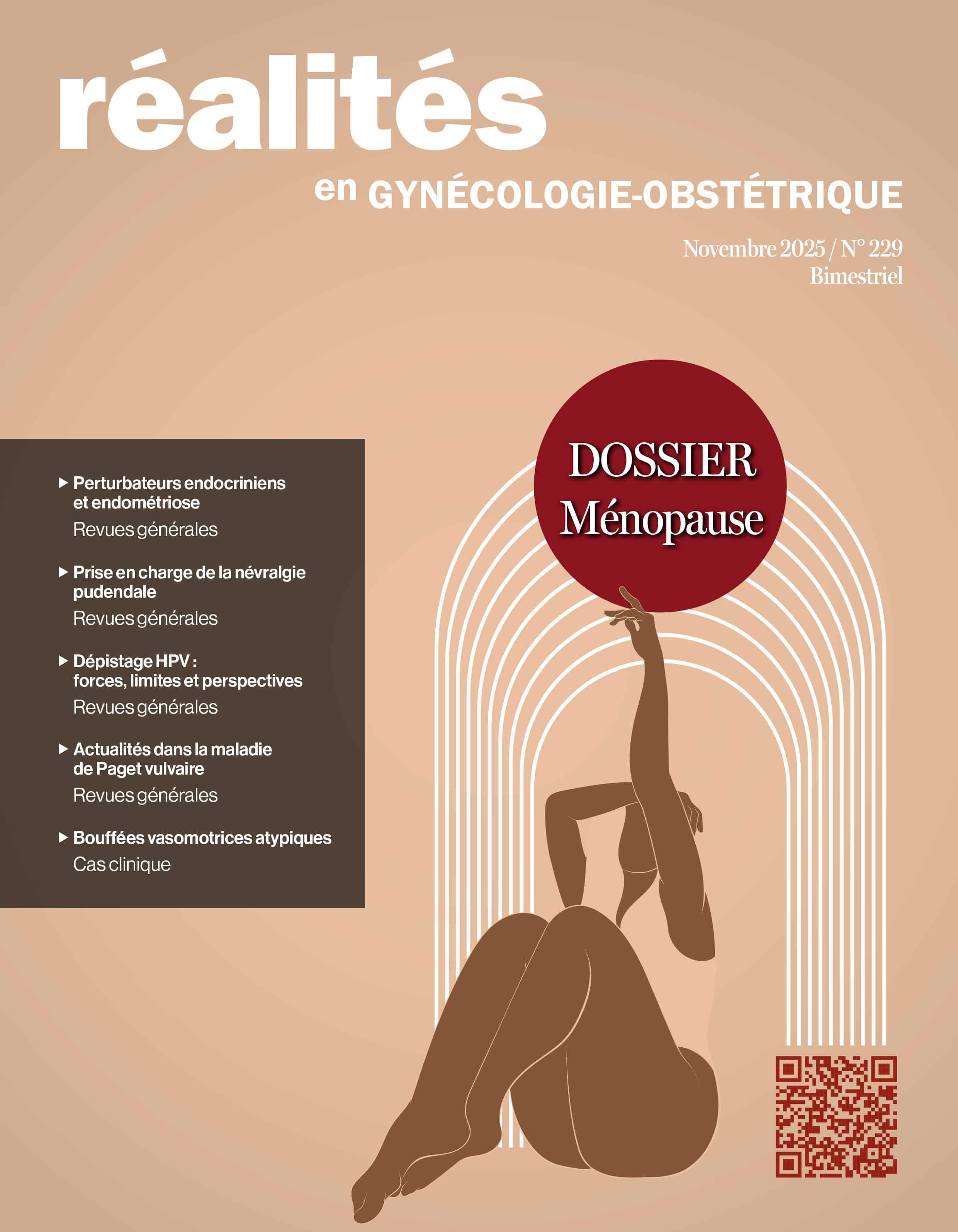Accouchement par voie basse : quelles informations donner ?
En matière médico-légale, les données du Groupe Relyens, premier assureur européen en responsabilité médicale, montrent qu’un accouchement par voie basse a été réalisé dans 47 % des dossiers d’obstétrique étudiés. Cette modalité d’accouchement est nécessairement discutée en expertise et implique que l’information sur ses risques ait bien été délivrée en amont auprès de la patiente. L’information doit être délivrée au cours d’un échange le plus équilibré possible entre le médecin et la patiente, la bonne compréhension du message dépendant de la qualité de la communication.
Sur un plan légal, le médecin doit informer la patiente sur les complications particulières auxquelles elle et son enfant sont exposés s’il perçoit un risque de survenue de ces complications en laissant l’accouchement se dérouler par voie basse. Par la suite, il doit lui proposer l’alternative que représente une césarienne, tout en lui présentant l’analyse bénéfices/risques de chacune des solutions.
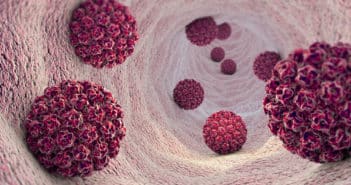
Que faire des lésions de bas grade persistantes ?
Les lésions intraépithéliales de bas grade (LIEBG) sont des manifestations le plus souvent transitoires de l’infection à human papilloma virus (HPV), régressant spontanément dans la majorité des cas. Elles ne doivent donc pas être considérées comme des lésions précancéreuses.
En cas de LIEBG persistante sans ambiguïté diagnostique (concordance cyto/colpo/histo, ZT1 ou 2), une prise en charge thérapeutique n’est à envisager qu’au bout de 2 ans de persistance et n’est pas systématique. La poursuite de la surveillance peut être proposée. Si un traitement est envisagé, le laser est à privilégier pour sa faible morbidité, comparée à celle de l’exérèse.
Les indications d’exérèse sont limitées aux situations où une lésion intraépithéliale de haut grade (LIEHG) peut être sous-estimée : cytologie initiale HSIL ASCH AGC, discordance cyto/colpo/histo, ZT3.

Évolution de la cytogénétique anténatale
En matière de cytogénétique prénatale, il existe une grande diversité de techniques maintenant disponibles. Celles-ci cherchent à analyser le contenu génétique des chromosomes. La pratique des examens de dépistage et de diagnostic des anomalies chromosomiques est très réglementée en France pour éviter une mauvaise utilisation de ces tests. Cela ne dispense pas de donner les bonnes informations aux femmes enceintes avant tout dépistage ou diagnostic cytogénétique et lors du rendu d’un résultat. La gestion des cas avec une anomalie avérée et des cas les plus complexes doit être faite en collaboration avec les Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN).

Malformations fœtales chirurgicales en urgence à la naissance
Les progrès réalisés en termes de diagnostic anténatal permettent aujourd’hui une prise en charge adaptée à chaque pathologie dans des centres spécialisés. Certaines pathologies engagent le pronostic des nouveaux-nés et doivent faire l’objet d’une expertise chirurgicale infantile au plus vite. Ainsi les suspicions de pathologies nécessitant une prise en charge néonatale immédiate ou relative, sont transférés in utero dans une maternité de niveau 3 (de type chirurgical) afin d’améliorer la prise en charge de ces enfants. Cet article donne quelques exemples de ces pathologies chirurgicales.

Traitements des cancers de l’endomètre
Dans la majorité des cas, les cancers de l’endomètre sont diagnostiqués chez des femmes ménopausées à un stade précoce. Le traitement est alors fondé sur l’hystérectomie associée à la procédure du ganglion sentinelle.
La décision de traitement adjuvant est dorénavant fondée sur la classification biomoléculaire en plus du stade et des caractéristiques anatomopathologiques classiques.
À un stade avancé, le traitement du cancer de l’endomètre utilise une approche multimodale combinant chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie. A contrario, lorsqu’il est diagnostiqué chez une femme en âge de procréer et en l’absence d’infiltration myométriale, un traitement conservateur peut être envisagé.

Grossesse et apnée du sommeil
L’apnée du sommeil (AS) est sous-diagnostiquée chez la femme en général et encore plus au cours de la grossesse. La prévalence de l’AS est faible quand la grossesse est sans particularité mais la valeur bondit quand sont présents par exemple un âge ≥ 30 ans, un IMC préconception ≥ 30 kg/m2, un diabète gestationnel ou un trouble hypertensif de la grossesse (comprenant prééclampsie et éclampsie). Les conséquences d’une AS peuvent être sévères pour la mère et l’enfant et sont susceptibles de se prolonger au-delà de la grossesse. Chez la femme enceinte, les méthodes diagnostiques de l’AS et les critères de prescription d’une ventilation nocturne n’ont rien de particulier. Après le post-partum, un suivi précoce est nécessaire.

Quelle courbe de croissance utiliser ?
Le dépistage des anomalies de croissance n’est pas satisfaisant en France, notamment un taux de dépistage de petit fœtus pour l’âge gestationnel très insuffisant, avec une sensibilité proche de 20 %. De plus, l’apparition récente des courbes prescriptives a amené les sociétés savantes à évaluer ces nouvelles courbes par rapport aux courbes descriptives utilisées actuellement. Il a été ainsi montré que les courbes locales conduiraient à un possible sous-diagnostic des petits périmètres crâniens et donc des microcéphalies ainsi que des PAG/RCIU. Les courbes prescriptives Intergrowth sous-estimeraient les fœtus PAG en surestimant les fœtus GAG. Ainsi, les sociétés savantes françaises recommanderaient dorénavant d’utiliser les courbes de biométrie élémentaire (PC, PA, LF), ainsi que la courbe d’EPF par sexe, de l’OMS, car ce référentiel rapporterait une proportion de fœtus dépistés adéquate à la population française. Enfin, ces mêmes sociétés recommanderaient l’utilisation des courbes néonatales et postnatales de Fenton actualisées.

Suicide maternel en période périnatale, l’urgence d’un protocole de dépistage anténatal en maternité : l’expérience de Robert-Debré
Les résultats du 6e rapport de l’Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM), qui positionnent les décès par suicide en deuxième cause de mortalité maternelle, ont ouvert une réflexion autour des pratiques dans les services de gynécologie-obstétrique, donnant une place essentielle à la santé mentale maternelle et infantile. Du fait de son caractère évitable dans 90 % des cas, une optimisation de l’organisation des soins semble nécessaire.
Les grossesses chez les femmes présentant des troubles psychiatriques et/ou des vulnérabilités psychosociales entraînent des risques obstétricaux et pédiatriques augmentés. Ces grossesses sont donc dites “à risque” (obstétrical, pédiatrique et psychiatrique), c’est pourquoi il faut penser l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte dans sa globalité.

Bouffées vasomotrices : quels traitements proposer ?
Les bouffées vasomotrices (BVM) représentent l’un des symptômes majeurs du syndrome climatérique, avec un impact sur la qualité de vie. L’estrogénothérapie en constitue le traitement le plus efficace. L’utilisation d’un traitement hormonal de la ménopause (THM) a fait l’objet de nombreuses controverses ces dernières années, notamment concernant les risques carcinologiques. Des recommandations des sociétés savantes ont été publiées récemment, permettant de guider le professionnel de santé. L’initiation d’un THM doit, au préalable, éliminer des contre-indications au traitement. Un suivi régulier évaluant la balance bénéfices-risques est nécessaire, avec une participation active de la patiente à son traitement et l’information sur les règles hygiéno-diététiques.

Thérapeutique de l’endométriose : nouveautés
L’endométriose est une maladie inflammatoire chronique, définie par la présence de tissu endométrial en dehors de l’utérus, responsable de douleurs pelviennes et d’infertilité. Cette maladie doit être considérée comme un problème de santé publique ayant un impact majeur sur la qualité de vie des femmes avec un coût socioéconomique important. Le diagnostic de l’endométriose est aujourd’hui non chirurgical et repose sur un processus structuré associant l’interrogatoire, l’examen clinique et l’imagerie. Ce changement de paradigme sur le plan diagnostique a des conséquences importantes en matière de stratégie thérapeutique. Trois options principales peuvent être proposées aux patientes : les traitements hormonaux, la chirurgie et l’assistance médicale à la procréation. La gestion moderne de l’endométriose doit être multidisciplinaire, individualisée et tenir compte des désirs et des priorités de la patiente.