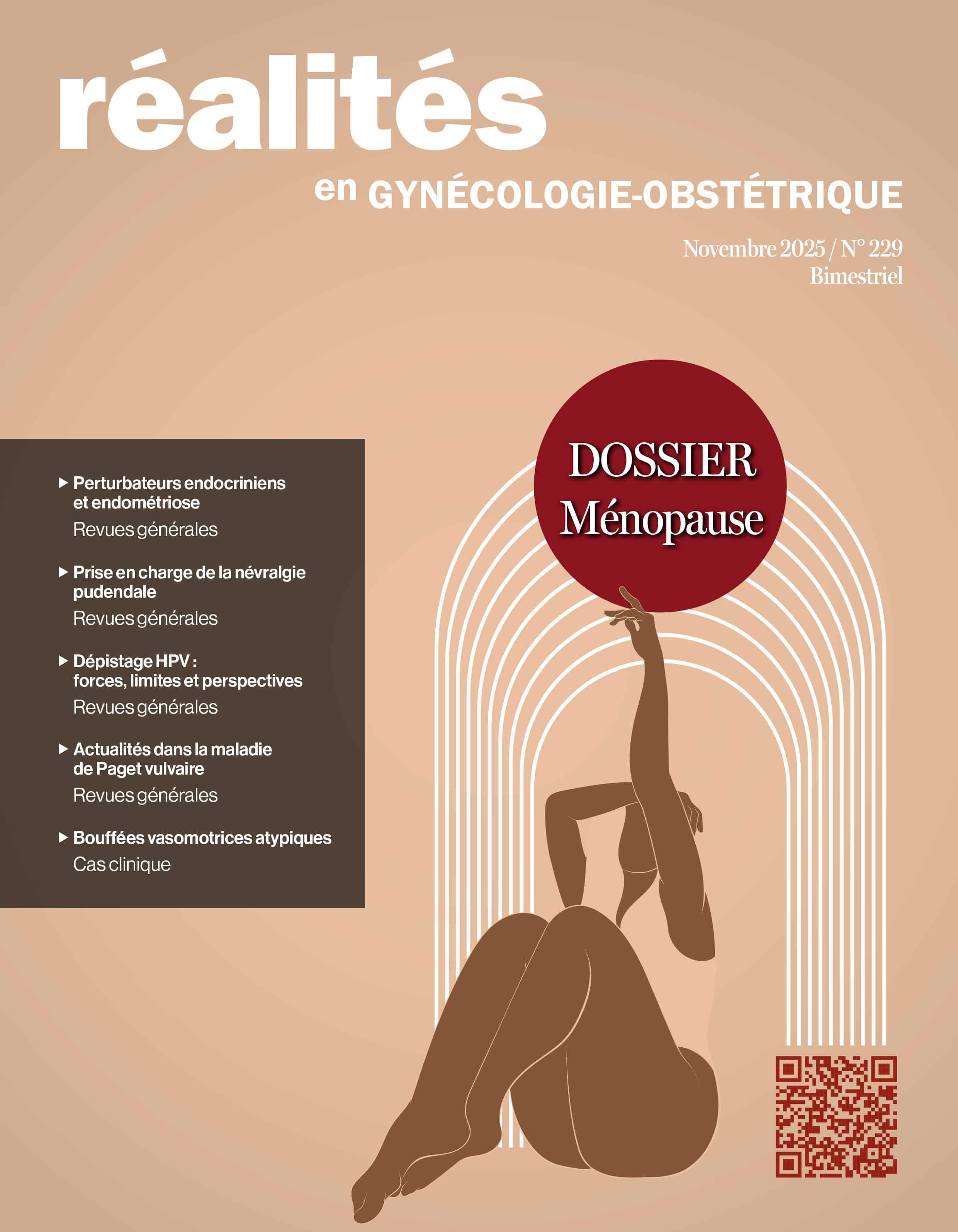Effets secondaires des vaccins HPV : mythe ou réalité ?
Depuis l’introduction de la vaccination anti-HPV (HPV, Human papillomavirus), en 2007, 80 millions de doses ont été injectées dans le monde et 4 millions en France. La tolérance des vaccins à court et moyen terme est très satisfaisante. Les effets indésirables sont fréquents sur le site d’injection (> 80 %) et peuvent s’accompagner d’effets systémiques transitoires dans 20 à 30 % des cas. Ils sont de faible intensité et n’ont quasiment aucune influence sur le déroulement du protocole vaccinal.
La fréquence de survenue d’EIS (effets indésirables sévères) n’est pas influencée par la vaccination. Aucun décès n’a été attribué à la vaccination anti-HPV. Malgré l’efficacité et la tolérance remarquable de la vaccination anti-HPV, elle fait malheureusement l’objet de rumeurs négatives qui empêchent sa diffusion et l’obtention d’une couverture vaccinale efficace en termes de santé publique dans plusieurs pays.

Enjeux éthiques du dépistage prénatal de la trisomie 21 à l’heure de l’analyse de l’ADN fœtal libre circulant
Depuis 2013, l’analyse de l’ADN fœtal libre circulant à des fins de dépistage de la trisomie 21 est de plus en plus utilisée, hors de toute stratégie nationale de dépistage. À l’heure où la Haute Autorité de santé (HAS) envisage les modalités d’intégration de cette approche dans la stratégie actuelle, il est essentiel que certains enjeux éthiques en rapport avec le dépistage prénatal non invasif (DPNI) soient envisagés dans le contexte économique contraint qui est le nôtre.
Ce dépistage, plus performant semble-t-il que le dépistage combiné du premier trimestre et répondant à des attentes sociétales légitimes, ne favorise-t-il pas plus encore une sélection des enfants à naître ? Cette question, qui est celle de la finalité de la performance technologique appliquée au champ du dépistage prénatal, nous amènera à examiner le problème central de l’information des professionnels et des patientes, indispensable pour envisager un choix éclairé et autonome.

Androcur® : les inquiétudes des patientes
L’acétate de cyprotérone est un progestatif, à la fois antigonadotrope et anti-androgénique. L’effet anti-androgénique est dose-dépendant. L’acétate de cyprotérone est utilisé dans le traitement de l’hirsutisme non tumoral (idiopathique ou lié à un syndrome des ovaires polykystiques). Il n’a pas l’AMM dans le traitement de l’acné ou de l’alopécie androgénogénétique.
Des effets secondaires sont possibles, mais ils sont rares aux doses utilisées dans ces indications. Un bilan préthérapeutique est nécessaire pour vérifier l’absence de contre-indications, les plus importantes étant les antécédents d’accidents thromboemboliques, une grossesse, un méningiome ou une altération de la fonction hépatique.

Conduite à tenir devant un FCV ASCUS
Les frottis cervicovaginaux (FCV) ASCUS (Atypical squamous cells of undetermined significance) représentent 150 000 frottis sur les 6 millions de frottis annuels français, soit 2,5 %. C’est l’anomalie la plus souvent rencontrée lors d’anomalies cytologiques, avec une prévalence importante jusqu’à l’âge de 50 ans.
La difficulté réside à faire le dépistage de lésion cervicale de grade élevé, sans inquiéter une population de femmes indemnes de lésion.
La réalisation de frottis en phase liquide permet, dans un deuxième temps, la recherche du génotype de l’HPV (Human papillomavirus) qui va orienter la prise en charge diagnostique. L’avantage du test viral est sa plus grande sensibilité par rapport à la répétition des frottis et du “triage” des patientes à risque.
La colposcopie est l’examen final à réaliser devant une patiente frottis ASCUS-HPV positif afin d’éliminer une lésion de haut grade.

Intérêt de la mammographie avant 50 ans
Le cancer du sein existe avant 50 ans puisque l’on notait, en 2005, 10 600 cas dont 8 200 entre 40 et 50 ans, soit 16 % de l’ensemble des cancers du sein.
L’efficacité de la mammographie de dépistage est démontrée pour cette tranche d’âge, mais elle s’accompagne de davantage de faux positifs et de faux négatifs. En dehors d’un contexte de cancer du sein héréditaire associé à une mutation de type BRCA, les principaux facteurs de risque pour cette tranche d’âge sont les antécédents familiaux, la densité mammaire et les hyperplasies atypiques.
On pourrait envisager une mammographie de référence à 40 ans et un suivi adapté, en fonction des facteurs de risque de chaque femme.

Prise en charge des vulvodynies
Les vulvodynies sont définies comme un “inconfort vulvaire chronique, le plus souvent à type de brûlure, sans lésion visible pertinente et sans maladie neurologique cliniquement identifiable”. Le gynécologue a un rôle central d’identification de cette pathologie mal connue et sous-diagnostiquée. Il coordonne la prise en charge multidisciplinaire (qui sera longue), en ayant à l’esprit que les patientes ont derrière elles un long périple de consultations médicales diverses avec la prescription de nombreux traitements topiques inappropriés.
La vestibulodynie provoquée, qui est la forme la plus fréquente de vulvodynie et l’apanage de la femme jeune, est déclenchée par un stimulus qui ne devrait pas être algique. Les patientes décrivent surtout une dyspareunie d’intromission. Les principaux diagnostics différentiels sont le vaginisme et la névralgie pudendale.
La prise en charge comprend des antidépresseurs tricycliques à doses antalgiques, une kinésithérapie (biofeedback) et une psychothérapie. Si les patientes sont résistantes à la première ligne thérapeutique, de nouvelles thérapeutiques sont encore à l’étude (toxine botulique A).

Pessaire versus cerclage versus expectative pour les cols ouverts avec la poche des eaux visibles au deuxième trimestre
La prématurité concerne 11,39 % des grossesses aux ÉtatsUnis. Elle est la principale responsable de morbi-mortalité néonatale. Les patientes enceintes singleton ayant un col dilaté avec des membranes exposées au 2e trimestre ont un risque d’accouchement prématuré de 90 %. Les options thérapeutiques sont limitées. En effet, le repos strict au lit n’est pas prouvé dans ces situations. Il semble même plutôt délétère avec une augmentation des thromboses veineuses profondes et embolie pulmonaire, responsables aussi d’accouchement prématuré. Le cerclage reste le traitement proposé en première intention entre 14 et 24 semaines d’aménorrhée (SA), réduisant ainsi le risque d’accouchement prématuré de 70 % avant 28 SA et de 64 % avant 32 SA. Cependant, il présente des risques comme la rupture prématurée des membranes, des saignements par déchirure cervicale et enfin des chorioamniotites.

L’obésité maternelle a-t-elle un retentissement sur le fœtus et l’enfant futur ?
L’obésité progresse dans le monde et en France. La grossesse chez la femme obèse est parti-culièrement à risque de complications obstétricales et néonatales.
De plus, l’obésité maternelle joue sur le poids de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte futur. Elle a également des répercussions sur la santé de l’adolescent et de l’adulte futur (diabète, maladies cardiovasculaires), et diminue leur espérance de vie.
Pour toutes ces raisons, il devient nécessaire de prendre en charge une femme en surpoids ou obèse avant la conception et pendant la grossesse.

Vin classique et imiquimod
De nombreuses études de bonne qualité attestent de l’efficacité de l’imiquimod pour traiter les VIN classiques. La chirurgie, quant à elle, garde toute sa place pour les lésions localisées, en association ou non avec l’imiquimod.
Ce traitement, assez “technique” à utiliser, nécessite des explications détaillées sur les modes d’application et sur les éventuels effets secondaires locaux ou généraux.

Cloison utérine : faut-il sectionner ?
La section hystéroscopique d’une cloison utérine est un geste techniquement simple et peu risqué. Néanmoins, la plupart des cloisons sont asymptomatiques, et il n’est pas évident que la cloison puisse toujours être incriminée dans les accidents de la reproduction ou une infertilité.
La section de cloison utérine ne fait pas complètement disparaître le risque de survenue des accidents de la grossesse, d’une part, et ne ramène pas le taux d’obtention de grossesse à celui de la population générale chez les femmes infertiles, d’autre part.
Dans ces conditions, l’indication du geste doit être discutée au cas par cas, à la lumière des antécédents et du bénéfice attendu.