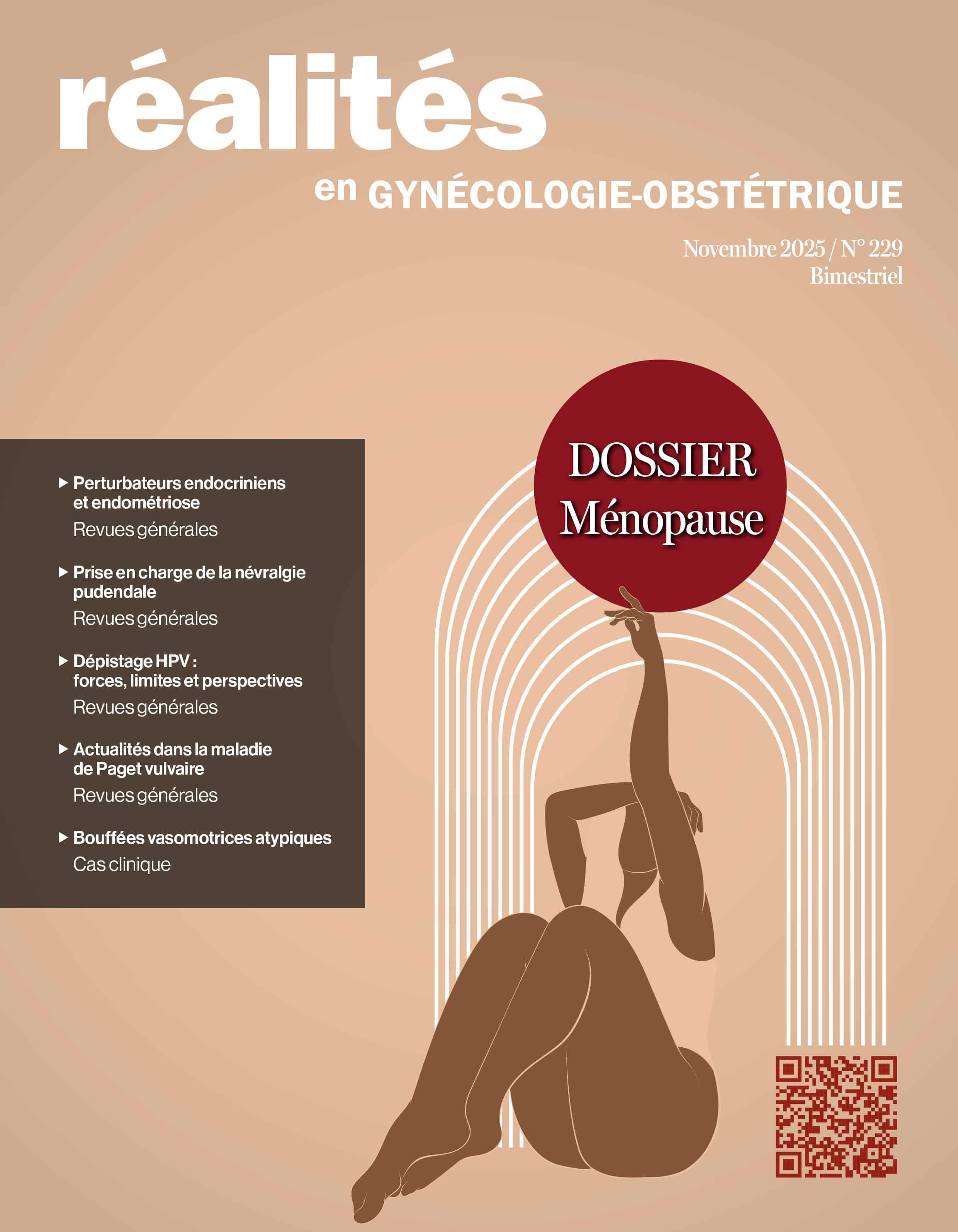À qui proposer une mastectomie prophylactique ?
La mastectomie prophylactique ayant connu un essor ces cinq dernières années, nous, cliniciens, sommes confrontés à un nombre croissant de demandes de patientes. S’agissant des patientes mutées indemnes, la mastectomie prophylactique constitue le meilleur moyen de prévention du cancer du sein et celle-ci doit être discutée avec elles. Les patientes jeunes qui ont une histoire familiale lourde et sont porteuses de la mutation BRCA1 sont susceptibles d’en bénéficier le plus.
Chez les patientes porteuses d’une mutation BRCA ou à haut risque familial sans mutation retrouvée et qui ont eu un cancer du sein, la mastectomie bilatérale (MBP) ou controlatérale prophylactique (MCP) a un intérêt en termes de diminution du risque de survenue d’un autre cancer et un impact sur la survie. Elle fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Enfin, chez les patientes sans risque génétique, le bénéfice de la MCP est très incertain (théoriquement inférieur à 1 % sur la mortalité), surévalué d’un point de vue oncologique (seules les patientes jeunes, de stade précoce RH- pourraient en bénéficier) et difficile à appréhender d’un point de vue psychologique.

Comment explorer les douleurs pelviennes chroniques ?
Les douleurs pelviennes chroniques représentent un symptôme fréquemment signalé par nos patientes. La difficulté de leur exploration réside dans la multitude d’examens complémentaires mis à notre disposition qu’il faudra adapter à chaque situation grâce à un interrogatoire et à un examen clinique minutieux.
L’échographie abdomino-pelvienne avec Doppler permettra de réaliser un premier état des lieux en recherchant une étiologie gynécologique. Une consultation avec un psychologue ou un psychiatre devrait être systématiquement proposée au début de la prise en charge. Ensuite, une IRM pelvienne, voire une cœlioscopie, pourra être proposée afin de rechercher une éventuelle pathologie endométriosique, adhérentielle ou inflammatoire chronique.
Une prise en charge multidisciplinaire apparaît indispensable.

Indications actuelles de l’aspirine en obstétrique
Alors que l’aspirine était autrefois largement prescrite par les gynécologues-obstétriciens, ses indications se sont peu à peu restreintes. Les deux principales sont la prévention de la récidive d’une pathologie vasculaire placentaire et la prévention des accidents obstétricaux en association aux anticoagulants dans le cadre du syndrome des antiphospholipides (SAPL).
Le traitement sera débuté le plus tôt possible à la dose de 100 à 160 mg par jour et poursuivi jusqu’à 35 semaines d’aménorrhée (SA).
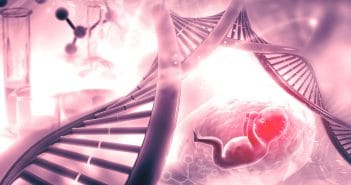
Dépistage prénatal non invasif des anomalies chromosomiques dans le sang maternel : quelles indications ?
Le dépistage de la trisomie 21 a considérablement évolué depuis quelques années. L’arrêté de 2009 a permis l’accès à un dépistage combiné au 1er trimestre pour toutes les patientes qui le souhaitent. Néanmoins, cette technique présente un taux de faux positifs non négligeable, avec pour conséquence des fausses couches pour des fœtus exempts de trisomie 21.
Le développement des méthodes de dépistage prénatal non invasif modifie les pratiques actuelles du dépistage, en permettant de réduire de façon drastique le nombre de prélèvements invasifs chez les patientes à risque à l’issue du dépistage conventionnel. Toutefois, il ne s’agit pas d’un caryotype et ses indications sont donc à l’heure actuelle limitées. Par ailleurs, ses performances en population générale restent encore à préciser et ne permettent pas, pour le moment, de le proposer à l’ensemble des patientes en dépistage primaire.
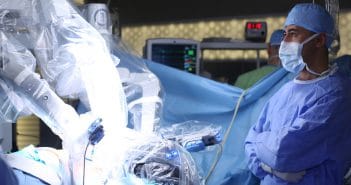
Intérêt de la chirurgie robotique dans le cancer de l’endomètre
Le cancer de l’endomètre est le cancer gynécologique le plus fréquent. La chirurgie mini-invasive doit être la voie d’abord chirurgicale à privilégier. Les avantages de la chirurgie robotique permettent de développer ces techniques mini-invasives car, à ce jour, en France, une majorité des cancers de l’endomètre sont encore opérés par laparotomie.
L’assistance robotique permet une prise en charge optimale des cancers à bas risque chez les patientes obèses et aide au développement de nouvelles techniques comme la chirurgie ambulatoire, l’abord par mono-trocart ou encore une prise en charge optimale en cas de cancer dit à haut risque de récidive. Il nous apparaît important de présenter ces avantages.

Interruption volontaire de grossesse sous anesthésie locale : mythe ou réalité ?
Contrairement à la plupart des pays européens, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) instrumentale en France est plus souvent pratiquée sous anesthésie générale dans un établissement de soins. Pourtant, cet acte chirurgical peut parfaitement être pratiqué en toute sécurité après application ou infiltration d’anesthésiques locaux, couplés ou non à l’administration de protoxyde d’azote ou de produits sédatifs sans altération de la conscience.
C’est principalement l’organisation du système de soins en France et la formation des praticiens impliqués dans l’IVG instrumentale qui limitent le développement de l’IVG sous anesthésie locale. La récente possibilité de pratiquer des IVG sous anesthésie locale dans les centres de santé peut certainement contribuer à la diffusion plus large de cette technique en France.

Incontinence urinaire chez la femme jeune
La prise en charge de l’incontinence urinaire de la femme jeune est loin d’être standardisée. En effet, peu d’études s’adressent aux particularités de cette population, dont les caractéristiques nécessitent pourtant une prise en charge adaptée. D’une part, le risque de récidive et de complications à long terme pourrait être augmenté chez ces patientes plus actives et dont l’espérance de vie est plus importante. D’autre part, le retentissement des potentiels grossesses et accouchements à venir doit être pris en compte pour la prise en charge.
Les bandelettes sous-urétrales représentent le traitement chirurgical de première intention pour l’incontinence urinaire d’effort. Les résultats fonctionnels de cette technique semblent peu altérés par les grossesses et le temps, mais le taux de complications pourrait être augmenté à long terme.
La césarienne ne prévient ni la survenue de l’incontinence urinaire de novo à long terme, ni la récidive d’incontinence chez la patiente déjà traitée. De nouvelles investigations basées sur des registres nationaux, des études de cohortes à long terme et des études randomisées devraient mieux guider la prise en charge de l’incontinence urinaire des patientes jeunes.

Infertilité inexpliquée : quelle stratégie de prise en charge ?
L’infertilité inexpliquée est définie par l’absence de conception spontanée après un certain délai de rapports sexuels réguliers, malgré un bilan normal des facteurs de fertilité du couple.
Il est recommandé de mettre en route un bilan après 1 an de rapports réguliers avant 35 ans, plus rapidement au-delà.
L’expectant management est surtout recommandé avant 35 ans. Tout traitement est par définition empirique. La stimulation ovarienne orale a une efficacité incertaine. La stimulation par FSH et insémination intra-utérine est plus courte, plus simple et moins artificielle que la FIV, mais n’apporte pas d’informations sur la cause de l’infertilité en cas d’échec.
La fécondation in vitro est recommandée d’emblée à partir de 38 ans, et même avant cet âge pour le NICE. Les éléments de preuve sont cependant faibles et il reste à ce stade une place pour l’insémination en première intention avant 38 ans. L’arbre de décision est donc essentiellement basé sur l’âge de la femme et la durée d’infertilité.

Homéopathie et grossesse : les grandes indications
L’homéopathie est une médecine complémentaire totalement personnalisée qui considère l’être humain dans sa globalité, en prenant en compte non seulement les données physiques, mais aussi le vécu, l’environnement et l’hérédité de la personne.
Les remèdes homéopathiques ne présentent aucune toxicité et peuvent être utilisés en même temps qu’un traitement médicamenteux classique. Leur action est curative, mais aussi préventive.
L’homéopathie convient donc parfaitement à la période de la grossesse et au post-partum : elle pourra aider les patientes à bien vivre les 9 mois précédant la naissance et les semaines suivantes en soulageant les petits maux et autres troubles sans porter atteinte à la santé du bébé. Elle a également toute sa place pendant l’accouchement, dans l’accompagnement du travail eutocique mais aussi dystocique, et dans la prise en charge de certaines complications.

Contraception chez les femmes à risque cardiovasculaire
Compte tenu du risque d’accident cardiovasculaire artériel et veineux – certes, très faible en valeur absolue – généré par certaines méthodes de contraception hormonale (notamment les contraceptions estroprogestatives), la recherche des facteurs de risque vasculaire est incontournable avant toute prescription de contraceptifs hormonaux.
L’objectif de cette revue est de voir comment la présence de certains d’entre eux doit influencer le choix contraceptif. Si la présence de certains facteurs de risque constitue une contre-indication absolue et définitive aux estroprogestatifs, la présence d’autres facteurs de risque n’exclue en revanche pas leur prescription mais seulement sous certaines conditions.