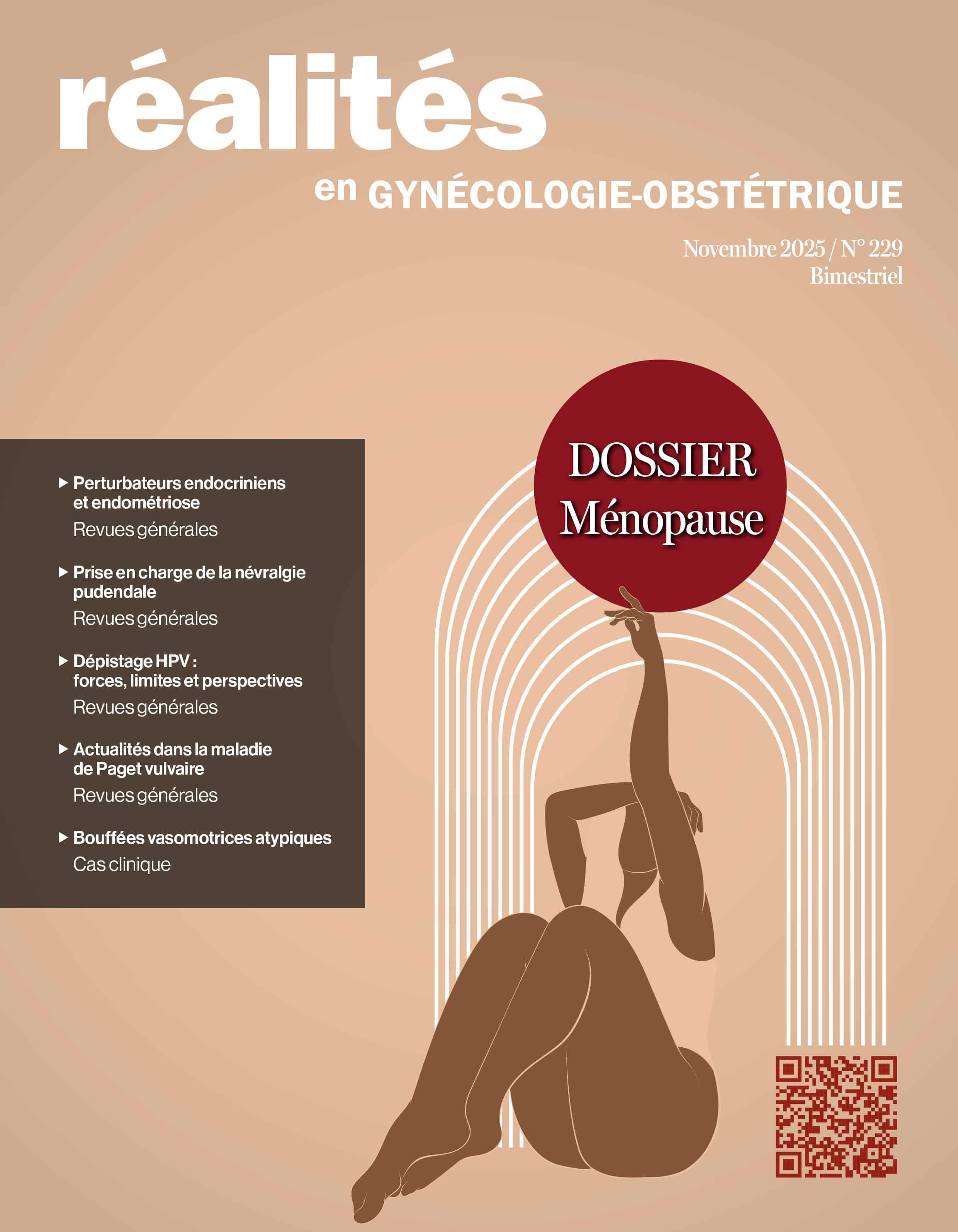Les temps opératoires de la césarienne
La césarienne est l’une des interventions chirurgicales les plus fréquemment réalisées et les techniques opératoires sont très nombreuses.
Nous avons analysé les données de la littérature afin de savoir si une technique était associée à une augmentation du risque de morbidité maternelle. L’incision de Cohen semble réduire le risque de morbidité maternelle à court terme comparativement à l’incision de Pfannenstiel. Concernant les autres techniques (extériorisation de l’utérus, fermeture en un plan de l’hystérotomie, fermeture du péritoine, fermeture sous-cutanée et cutanée), aucune n’est associée à une réduction du risque de morbidité maternelle à court terme.
Les complications maternelles à long terme (comme le risque d’adhérence, de rupture utérine) restent à évaluer par des études de qualité méthodologique solide. Chaque opérateur peut donc réaliser une césarienne selon ses habitudes et ses préférences.

Incontinence urinaire par hyperactivité vésicale
Concernant près de 20 % de la population féminine, l’hyperactivité vésicale est un handicap majeur dans la vie quotidienne. Le diagnostic est essentiellement clinique, reposant sur l’interrogatoire. La recherche d’une étiologie grâce à des examens simples comme l’ECBU et l’évaluation du résidu post-mictionnel est indispensable, mais cette affection est le plus souvent idiopathique.
Si la symptomatologie est mixte (fuites à l’effort et par urgenturie), s’il existe une pathologie neurologique sous-jacente (sclérose en plaques, maladie de Parkinson, accident vasculaire cérébral…) ou si une première ligne de traitement a échoué, l’examen urodynamique permet l’expertise de l’équilibre des pressions urétrovésicales.
La prise en charge est d’abord rééducative et comportementale, puis médicamenteuse (principalement par les anticholinergiques) et enfin, en cas d’échec, des traitements plus invasifs comme les injections intradétrusoriennes de toxine botulique ou la neuromodulation sacrée sont proposés.

Dysthyroïdie et grossesse : le point en 2017
La formation embryologique de la thyroïde fœtale débute dès le 1er trimestre de la grossesse. La glande devient réellement fonctionnelle vers 20/22 SA. La thyroïde fœtale est régulée par des facteurs extérieurs à la barrière placentaire.
Le dépistage de routine à la recherche d’une hypothyroïdie subclinique n’est pas d’actualité, mais l’identification de patientes à risque semble importante au vu des risques obstétricaux clairement établis.
Il existe des outils diagnostiques nous permettant de suivre l’équilibre hormonal thyroïdien fœtal. Des traitements sont disponibles afin d’optimiser la prise en charge maternelle et fœtale.
Les cas douteux ou difficiles relèvent d’une prise en charge en CPDPN ou staff multidisciplinaire. La surveillance doit se poursuivre en post-partum, et l’allaitement sera envisageable après information et concertation entre pédiatres et parents.

Comment diagnostiquer et suivre une ostéoporose postménopausique ?
Pour diagnostiquer une ostéoporose chez la femme ménopausée, on utilise des outils d’évaluation du risque fracturaire. Le plus important est l’ostéodensitométrie, parfaitement validée en termes de risque fracturaire et de suivi des traitements.
Le Trabecular Bone Score (TBS), qui est un index de quantification des variations de niveaux de gris sur l’image d’acquisition du rachis en densitométrie, est utilisable en routine du fait de son caractère indépendant de la densitométrie et des facteurs de risque clinique.
Les marqueurs du remodelage osseux peuvent être une aide à la décision thérapeutique mais il n’est pas sûr qu’ils soient réellement indépendants de la masse osseuse et des facteurs cliniques. Ils sont utiles dans le suivi thérapeutique.
Récemment se sont développés des outils de prédiction des fractures sur une période de 10 ans, en particulier le score de FRAX, utilisable à l’échelon individuel avec quelques limites que le clinicien doit connaître. Il est particulièrement utile dans les situations de risque modéré et des ajustements par le TBS sont maintenant accessibles.

Connaître, dépister et prendre en charge les coccygodynies du post-partum
La coccygodynie correspond à une douleur du coccyx (du grec odunê [-odynie], douleur) sans irradiation particulière. Il s’agit d’une conséquence de 4 à 15 % des accouchements, souvent attribuée à une position inconfortable prolongée (en particulier en cas d’analgésie péridurale) ou au résultat du passage du mobile fœtal.
Ces douleurs s’amendent parfois spontanément dans les 2 mois qui suivent l’accouchement, mais leur persistance peut se révéler très invalidante au quotidien et impose une prise en charge adaptée. En effet, le traitement repose trop souvent sur les antalgiques simples et aboutit à une expectative nonchalante, source d’errance diagnostique et de chronicisation. Pourtant, la compréhension de cette pathologie et une prise en charge pluridisciplinaire et adaptée permettent d’obtenir une guérison dans 90 % des cas [1].

Dépistage organisé du cancer du sein
Quoi qu’on en dise, le cancer du sein est responsable de plus de 11 000 décès par an en France. Réduire la mortalité liée au cancer du sein reste un objectif fondamental en termes de santé publique.
Le dépistage organisé a permis une amélioration fondamentale du parc des mammographies et une formation des radiologues et des manipulatrices. Pour l’ensemble des femmes concernées âgées de 50 à 74 ans, il permet un égal accès à un dépistage de qualité sans barrières économiques. Il offre une double lecture de qualité réduisant au maximum les risques de faux négatifs.
Le dépistage organisé permet aussi une évaluation des pratiques et une évaluation des cancers diagnostiqués dans son cadre. Le bénéfice en termes de réduction de la mortalité est de l’ordre de 20 à 40 % selon les études prises en compte et selon la population de référence choisie (femmes invitées à participer au dépistage ou femmes y participant réellement).
Les progrès thérapeutiques réalisés depuis les années 1970 réduisent, et c’est tant mieux, l’efficacité du dépistage en augmentant les chances de guérison des patientes, mais ce n’est pas une raison pour abandonner le dépistage. C’est un choix de société, un choix économique, mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, ce serait un grand bond en arrière pour les femmes.
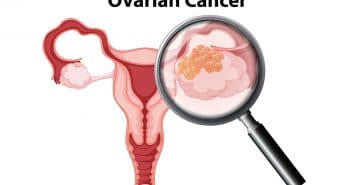
Impact de la salpingectomie prophylactique sur l’hormone antimüllerienne chez les patientes bénéficiant d’une hystérectomie par cœlioscopie : essai multicentrique randomisé.
Les études soutenant l’hypothèse selon laquelle la majorité des carcinomes ovariens séreux de haut grade seraient d’origine tubaire, et non ovarienne primaire, se sont multipliées au cours de la dernière décennie. Ainsi, une stratégie de prévention reposant sur l’association d’une salpingectomie “opportuniste” aux hystérectomies d’indication bénigne a été proposée. Cette pratique est aujourd’hui recommandée par de nombreuses sociétés savantes et l’on estime qu’elle permettrait une réduction du risque de cancer de l’ovaire de 20-40 % sur les deux prochaines décennies.

Nouveautés dans le syndrome génito‑urinaire de la ménopause, un mal‑être négligé chez la femme ménopausée
C’est dans le cadre du 7e congrès annuel du Groupe d’étude sur la ménopause et le vieillissement hormonal (GEMVI) que le laboratoire Pfizer a organisé un symposium consacré au syndrome génito-urinaire de la ménopause. Ce symposium a été présidé par C. Hocké (Bordeaux) et P. Lopès (Nantes).
Nous rapportons dans les lignes qui suivent les points forts des présentations de P. Lopès, B. Letombe (Lille) et G. André (Strasbourg).

Imagerie des anomalies urinaires en anténatal
Les anomalies congénitales des reins et des voies urinaires affectent 1/500 naissances vivantes et représentent 20 % de l’ensemble des anomalies majeures fœtales.
On oppose les anomalies obstructives des voies urinaires, avec notamment les obstructions pyélo-urétérales et vésico-urétérales, les reflux vésico-urétéraux et les valves de l’urètre postérieur, aux anomalies non obstructives des voies urinaires qui regroupent en particulier les méga-uretères primitifs, les agénésies rénales uni- ou bilatérales et les extrophies vésicales.
Les reins hyperéchogènes et kystiques recouvrent de nombreuses pathologies, à savoir la maladie rénale multikystique (polykystose rénale autosomique récessive et polykystose rénale autosomique dominante), la mutation HNF-1ß et certains syndromes géniques (les syndromes de Bardet-Biedl et Meckel-Gruber en particulier).
La réalisation d’échographies fœtales permet de détecter la majorité de ces malformations. L’IRM fœtale, technique d’imagerie de 2e intention, trouvera son intérêt dans le bilan de malformations complexes.

Conduite à tenir devant un pyosalpinx
Les pyosalpinx sont une pathologie fréquente, à l’origine de 100 000 hospitalisations annuelles aux États-Unis, et considérée comme une forme avancée ou compliquée d’infection génitale haute.
Les pyosalpinx compliquent 10 à 35 % des infections génitales hautes. Il s’agit souvent d’une infection polymicrobienne dont les germes les plus fréquents sont les entérobactéries, les streptocoques, les germes anaérobies et les bactéries responsables des infections sexuellement transmissibles. Le diagnostic précoce et la mise en route rapide du traitement sont essentiels pour diminuer le risque de séquelles comprenant l’infertilité, les grossesses ectopiques et les douleurs pelviennes chroniques.
Le traitement passe par une prise en charge médicale (antibiothérapie adaptée) à laquelle on associe un drainage radiologique ou chirurgical.