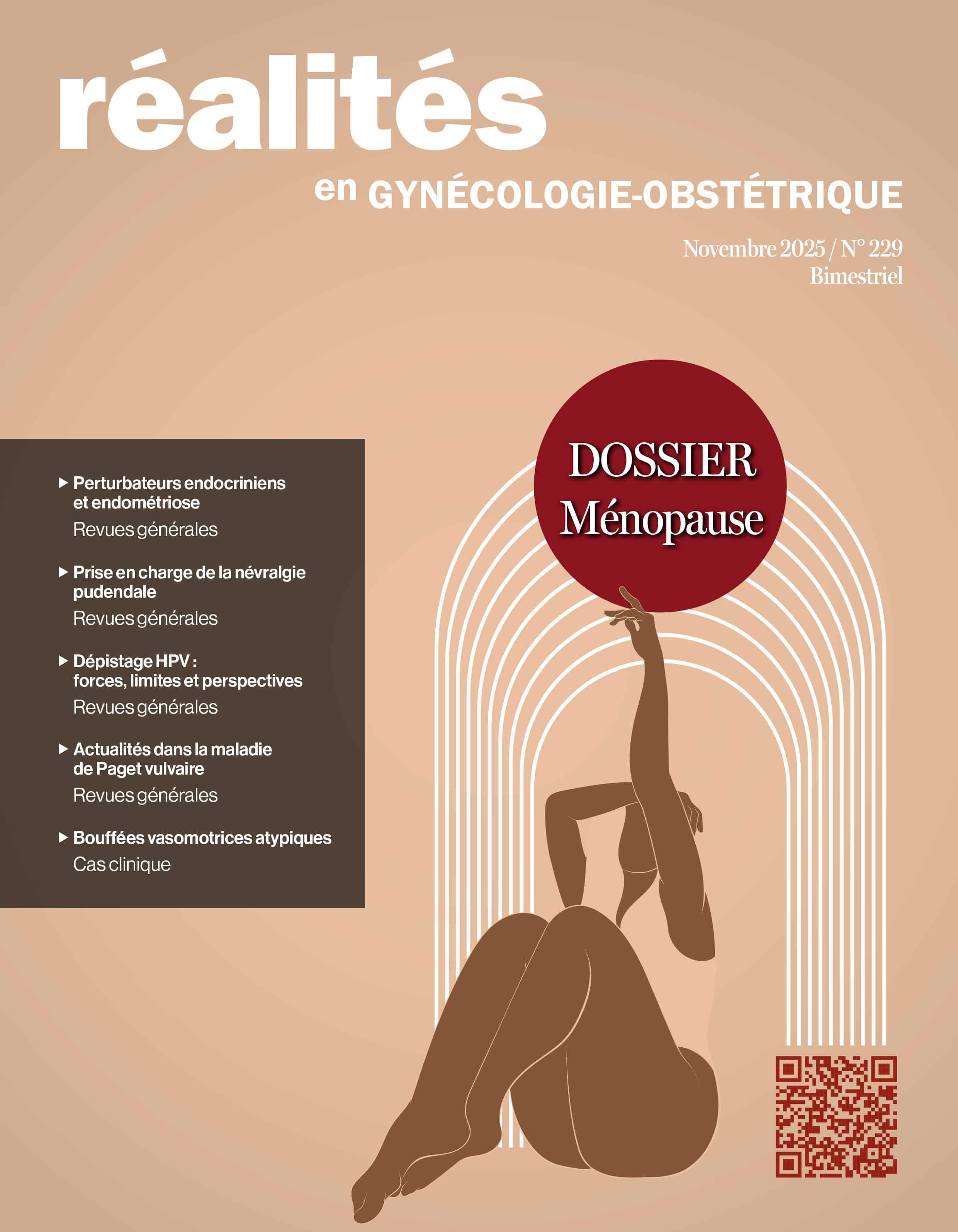Comment prendre en charge les infections urinaires à répétition de la femme ménopausée ?
Près de 50% des femmes présenteront au moins une infection urinaire au cours de leur vie. Après la ménopause, le risque augmente et les épisodes récidivants sont fréquents, favorisés par la carence œstrogénique. Il s’agit principalement de cystites provoquées par Escherichia coli.
Le traitement probabiliste est réservé aux épisodes de cystites aiguës simples survenant avant 75 ans et sans risque de complication. En cas de cystite à risque de complication ou de cystite récidivante, le choix de l’antibiothérapie repose sur le résultat de l’ECBU qui est réalisé à chaque épisode.
En parallèle de l’antibiothérapie curative, la prévention des récidives associe des conseils en matière d’hygiène et de miction, un apport hydrique quotidien suffisant et l’application vaginale d’œstrogènes. Une antibioprophylaxie au long cours est envisageable en dernier recours.

Le Syndrome de Lynch et le gynécologue
Le syndrome de Lynch est un syndrome héréditaire de transmission autosomique dominante qui prédispose principalement au cancer du côlon, mais aussi, chez la femme, au cancer de l’endomètre et de l’ovaire. Le diagnostic s’appuie sur des critères personnels et familiaux qu’il faut savoir identifier.
Récemment, les recommandations de traitement des cancers de l’endomètre ont vu apparaître des tests moléculaires tumoraux au diagnostic afin de classer les tumeurs. Il est donc important de savoir interpréter ces tests pour orienter au mieux les patientes. Le rôle du gynécologue va donc être central, tant dans le diagnostic que dans le suivi des femmes à risques.

Contraception et prédispositions génétiques au risque de cancer du sein ou de l’ovaire
On estime qu’environ 5 à 10 % des cancers du sein sont héréditaires et qu’environ 2 femmes sur 1 000 seraient porteuses d’un variant délétère (dit “mutation”) BRCA.
Les patientes porteuses d’une mutation BRCA présentent un risque très augmenté de cancer du sein ou de l’ovaire en comparaison avec les femmes de la population générale. Or, on sait que les contraceptions hormonales peuvent modifier le risque de présenter un de ces cancers.
En France, il n’existe aucune contre-indication à la prescription de traitements hormonaux chez les patientes porteuses d’une prédisposition génétique au cancer du sein et de l’ovaire, en l’absence d’antécédent personnel, mais il est important de pouvoir discuter des risques et bénéfices induits par ces traitements avec ces patientes souvent inquiètes de modifier leur risque déjà important.

Contraception et auto-immunité
Les maladies auto-immunes concernent 10 % de la population avec une majorité de femmes. Il existe un pic de fréquence au moment de la périménopause en lien avec les fluctuations hormonales, car les estrogènes jouent un rôle dans la réponse immunologique. Étant donné leur fréquence et leur âge de survenue, il est essentiel d’informer les femmes sur le type de contraception possible avec leur maladie. Par exemple, la contraception œstroprogestative n’est pas recommandée en cas de connectivite, car elle augmente le risque d’exacerbation de l’auto-immunité ainsi que le risque de maladie thrombo-embolique veineuse. Les microprogestatifs n’ont, eux, pas d’impact sur le risque vasculaire ou métabolique et sont donc utilisés de manière préférentielle chez les patientes lupiques. Enfin, il est possible de prescrire une contraception d’urgence, quelle que soit la maladie auto-immune que présente la patiente.

Quoi de neuf pour les tests de fertilité féminins en 2025 ?
Les tests de fertilité ont pour but de détecter les obstacles potentiels à la conception naturelle. À l’origine, ils sont circonscrits à l’exploration de l’infertilité et leur objectif est d’orienter les décisions professionnelles en matière d’assistance médicale à la procréation. Aujourd’hui, ils offrent de nouvelles perspectives pour l’évaluation et la gestion de la fertilité féminine. Les avancées dans ce domaine, telles que l’échographie 3D, mettent en lumière l’importance d’évaluations personnalisées en complément des initiatives d’information et de sensibilisation publiques qui jouent un rôle crucial dans la prévention de l’infertilité. Ces innovations, tel le Fertility Check Up (FCU), permettent une mesure plus complète de la fertilité féminine avec le bilan de la réserve ovarienne, de la perméabilité tubaire et de l’état utérin. Ces outils contribuent à une meilleure prévention de l’infertilité et à des conseils personnalisés pour les femmes en âge de procréer. L’éducation et l’information restent essentielles pour sensibiliser le public aux réalités de la fertilité humaine. Cet article explore les dernières innovations et les stratégies émergentes pour améliorer les tests de fertilité et leur accès.

Vulvites de la petite fille : conduite à tenir ?
La vulvite est une affection fréquente chez la petite fille, mais sa prévalence est cependant inconnue [1]. Elle survient en général entre 3 et 6 ans [2], chez des petites filles en cours d’autonomisation concernant la propreté, et disparaît spontanément vers l’âge de 8 ans. Il s’agit dans la quasi-totalité des cas de vulvites irritatives qui sont traitées par des règles d’hygiène simples. Il est alors indispensable d’expliquer à la famille que les vulvites peuvent récidiver en cas de relâchement des règles d’hygiène. La connaissance de la physiologie vulvaire de la jeune enfant est indispensable pour éviter de proposer des traitements inadaptés qui aggravent ou entretiennent la situation. Les autres causes de vulvite sont beaucoup plus rares et très faciles à distinguer cliniquement.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Depuis presque 30 ans que je suis rédacteur en chef de Réalités en Gynécologie-Obstétrique, j’ai essayé de vous offrir, dans chaque numéro, des dossiers, des articles, des mises au point qui ont suivi l’actualité de notre spécialité. De nombreux progrès ont marqué cette période, d’autres sont en émergence. Le Dr Clémence Delcour va désormais prendre le relais. Son parcours professionnel et son dynamisme sont autant d’atouts qui, j’en suis persuadé, pérenniseront la qualité et le succès de Réalités en Gynécologie-Obstétrique.
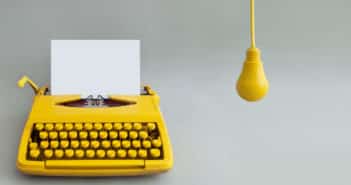
Écrivons un nouveau chapitre dans l’histoire de Réalités en Gynécologie-Obstétrique
L’histoire de Réalités en Gynécologie-Obstétrique et de Performances Médicales, la société éditrice, est avant tout celle d’une vision, portée par Richard Niddam, cardiologue de formation, qui a su conjuguer expertise médicale et excellence éditoriale. Fondée en 1990, Performances Médicales s’est rapidement imposée comme un acteur clé dans la presse et la communication médicales.

Faire du sport enceinte
Enceinte, la future maman souhaite adopter de saines habitudes de vie, pour se sentir bien et favoriser, autant que possible, le bon développement du bébé. C’est une période propice à la mise en place de “bonnes résolutions” alimentaires, sportives, psychologiques et, dans cette logique, l’activité sportive a toute sa place. Mais la future mère est souvent perdue entre les injonctions contradictoires : se reposer, rester active… En nous fondant sur de récentes publications scientifiques, rappelons les bénéfices, les contre-indications (absolues et relatives) et les conseils à donner aux femmes enceintes (notamment sur la course à pied). Nous verrons dans quel contexte orienter la femme enceinte vers un kinésithérapeute.

Le périnée et le corps après un accouchement
Les troubles pelvi-périnéaux sont des problèmes de santé courants, principalement liés à l’accouchement vaginal, à la chirurgie pelvienne, aux tensions chroniques et au vieillissement.
La grossesse et plus particulièrement l’accouchement par voie vaginale ont des répercussions négatives sur les fonctions du plancher pelvien pour près des 2/3 des femmes. Outre la pathologie pelvi-périnéale, d’autres dysfonctionnements doivent également être pris en considération, les plus fréquents étant les douleurs génito-pelviennes ou les troubles musculosquelettiques (fig. 1). La grossesse déclenche aussi un large éventail de changements dans le corps de la femme.