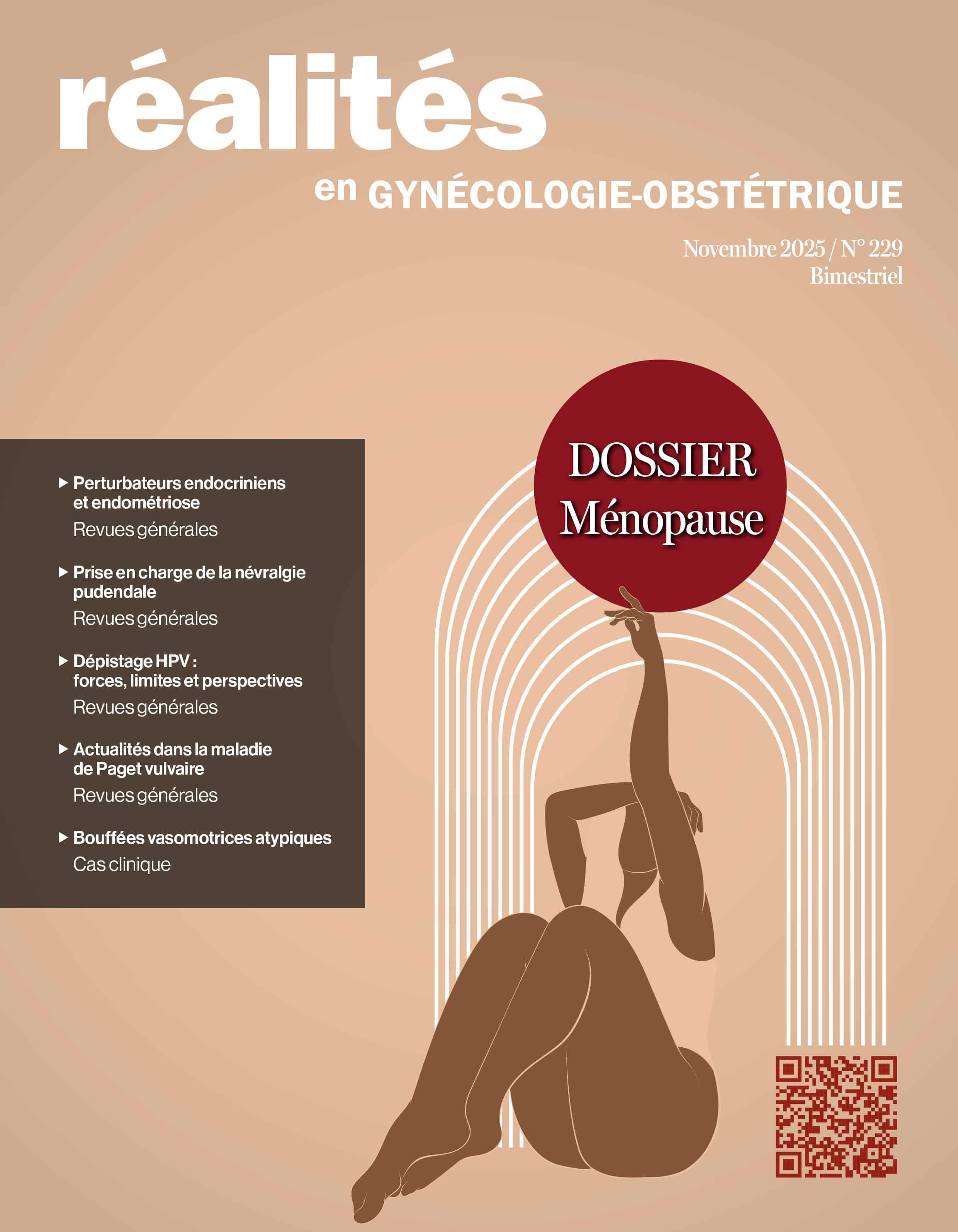Actualités des traitements du diabète gestationnel
Le diabète gestationnel est une hyperglycémie découverte pendant la grossesse qui doit être distinguée d’un diabète de type 2 méconnu. Seule une prise en charge globale associant diététique, activité physique et auto-surveillance glycémique (avec recours à l’insuline si les objectifs glycémiques ne sont pas atteints avec un régime bien suivi) diminue les complications périnatales. Les modifications quantitatives et qualitatives de l’alimentation ont un effet modéré. L’utilisation des hypoglycémiants oraux reste contre-indiquée pendant la grossesse.
La prise en charge du diabète gestationnel dépisté au 1er trimestre doit être envisagée chez des patientes en surpoids ou obèses et discutée chez des femmes de corpulence normale.

Dyspareunie profonde et colposcopie
L’examen colposcopique est un examen de 2e intention orienté par un frottis de dépistage anormal et dont la spécificité est améliorée par la sévérité du frottis de référence, un test HPV ou un double marquage P16+KI67. Il peut aussi être indiqué devant un antécédent de lésion traitée ou des métrorragies inexpliquées avec un frottis normal.
Mais la colposcopie peut parfois être un examen de 1re intention devant un col macroscopiquement inhabituel ou des signes d’appel cliniques parmi lesquels la dyspareunie profonde. Dans ce cas, les images colposcopiques vont enrichir la clinique et améliorer les performances diagnostiques.

Les pathologies thyroïdiennes au cours de la grossesse
L’hypothyroïdie, en particulier la maladie de Hashimoto, est la pathologie la plus fréquente au cours de la grossesse : les doses de Lévothyrox doivent être augmentées de 30 à 50 % dès le 1er trimestre. Il n’y a pas de risque de dysthyroïdie fœtale ou néonatale dans ce cas : la surveillance échographique fœtale sera habituelle.
La maladie de Basedow, en revanche, nécessite une consultation préconceptionnelle par des praticiens aguerris pour évaluer les risques materno-fœtaux. D’une part, il faudra arrêter les antithyroïdiens de synthèse tels que le carbimazole avant le 1er trimestre du fait de risques malformatifs en les remplaçant si besoin par du propylthiouracile. D’autre part, il faudra doser les anticorps antirécepteurs à la TSH (TRAK).
En dehors de ces deux situations de pathologie thyroïdienne connue, les femmes enceintes devraient recevoir une supplémentation iodée et un dépistage ciblé (sur facteurs de risque uniquement) d’hypothyroïdie maternelle par le dosage de la TSH en début de grossesse.

Concept de la LIL (Low Impact Laparoscopy)
Le concept de “Low Impact Laparoscopy” (LIL) est un protocole chirurgical mini-invasif associant une cœlioscopie à basse pression (moins de 10 mmHg) couplée à l’utilisation de trocarts de microcœlioscopie (3 mm). Les bénéfices de la basse pression sont déjà reconnus en chirurgie digestive par exemple, en matière de diminution des douleurs postopératoires. Ceux de la microcœlioscopie sont la diminution des douleurs postopératoires et l’absence de points de suture.
Le protocole LIL semble faciliter la réhabilitation grâce à un taux faible de douleurs et de nausées postopératoires. Dans notre pratique depuis 6 ans en chirurgie gynécologique, il facilite la prise en charge ambulatoire, qui est un objectif de santé publique. Son extension à des indications plus lourdes est à étudier.
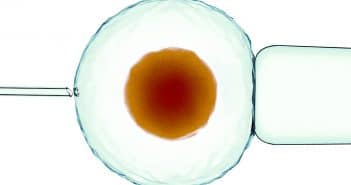
Quand passer en assistance médicale à la procréation ?
L’assistance médicale à la procréation (AMP) regroupe les activités d’insémination intrautérine, de fécondation in vitro, de don de gamètes et d’accueil d’embryons. Pour y accéder, l’infertilité doit avoir été médicalement diagnostiquée, et l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
L’infertilité tubaire (FIV si altération bilatérale, IIU si unilatérale), l’endométriose (IIU si légère, FIV si sévère), les troubles ovulatoires (dont le SOPK) après échecs d’une stimulation ovarienne, l’infertilité masculine (en cas de nombre de spermatozoïdes mobiles < 5 millions) et l’infertilité inexpliquée sont des indications de l’AMP. Les facteurs pronostiques de l’AMP pour l’obtention d’une grossesse sont l’âge féminin, l’indice de masse corporelle, la durée d’infertilité, la notion d’une grossesse antérieure, le nombre de follicules matures et la qualité de l’embryon obtenu.
En France, en 2016, plus de 50 000 inséminations et 60 000 fécondations in vitro ont été pratiquées.

Obésité, chirurgie bariatrique et grossesse
La grossesse après chirurgie bariatrique est une grossesse à risque qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire (médecin traitant, obstétricien/sage-femme, médecin nutritionniste, diététicien et chirurgien de recours). Si les pathologies maternelles (diabète gestationnel et hypertension artérielle gravidique) sont réduites d’environ 50 %, le risque de prématurité et de fœtus petit pour l’âge gestationnel est augmenté. Les besoins nutritionnels sont spécifiques, et nécessitent d’adapter les supplémentations et de renforcer la surveillance biologique chez ces femmes enceintes et pendant l’allaitement.
Les complications chirurgicales sont rares (déplacement de l’anneau gastrique, occlusion sur hernie interne après bypass, pathologies biliaires) mais doivent systématiquement être évoquées devant des vomissements ou des douleurs abdominales car leur pronostic dépend de la rapidité de prise en charge. Un délai de conception postopératoire d’au moins 12 mois devrait être respecté et une contraception efficace prescrite dans cette perspective, de préférence non orale.
Des études de cohortes sur le long terme sont absolument nécessaires pour augmenter les connaissances des enjeux de ces grossesses, notamment sur la programmation fœtale et le devenir à long terme des enfants.

HPV et cancer de l’anus
L’HPV est le virus le plus fréquemment transmis sexuellement. Il touche indifféremment les hommes et les femmes. Il est responsable de nombreux cancers gynécologiques mais également anaux et oropharyngés. Il peut être également responsable de lésions dysplasiques pouvant évoluer vers un carcinome, rester stables ou régresser.
Le dépistage des lésions dysplasiques est systématique chez les femmes au niveau du col et recommandé au niveau anal dans certaines populations dites “à risque”. La vaccination est sûre et efficace dans la prévention des cancers gynécologiques et de l’anus.

Surveillance radiologique des femmes à risque de cancer du sein
Les femmes à haut et très haut risque de cancer du sein doivent bénéficier d’une surveillance radiologique spécifique. La surveillance des femmes à très haut risque repose sur l’IRM mammaire associée à une mammographie par une seule incidence. La période de surveillance spécifique va de 30 à 65 ans. Les femmes à haut risque auront une surveillance annuelle par mammographie avec deux incidences.
Le test d’Eisinger permet facilement d’apprécier le risque génétique et d’adresser les patientes en consultation d’oncogénétique. L’étude européenne MyPeBS incluant 85 000 femmes va tenter de démontrer l’intérêt d’un dépistage personnalisé.

L’intelligence artificielle pour une prise en charge personnalisée et efficace en assistance médicale à la procréation
Pendant les années 1980, on cherchait à rattacher une fonction…

Maladie de Willebrand et grossesse
La maladie de Willebrand (MW) est une maladie hémorragique constitutionnelle très hétérogène sur le plan moléculaire, mais aussi au niveau du mode de transmission et des manifestations cliniques. Dans les formes sévères, le risque d’hémorragie est plus élevé lors des gestes invasifs et de l’accouchement, ce qui nécessite une prise en charge thérapeutique spécifique. Un protocole thérapeutique devra en effet être mis en place si les taux de facteurs sont inférieurs à 50 UI/dL, puis ils seront maintenus à ce niveau pendant le post-partum, sur une durée qui varie selon la voie d’accouchement.
Toute grossesse doit faire l’objet d’un suivi multidisciplinaire, au sein d’une maternité adaptée à la sévérité de la maladie. Le recours à l’analgésie péridurale est contre-indiqué dans les MW de types 2 et 3, et dans le type 1 si les taux de facteurs ne se sont pas normalisés. Les mesures de monitoring fœtal invasif et les manœuvres obstétricales traumatiques doivent être évitées. Chez le nouveau-né à risque de MW sévère, le dépistage peut être effectué à la naissance.