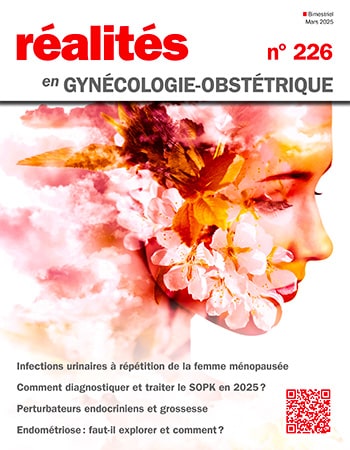Le diastasis des grands droits de l’abdomen (DGDA) fait référence à un amincissement et un élargissement de la ligne blanche, avec une laxité associée de la paroi abdominale antérieure. Il est souvent associé à une grossesse, mais des DGDA peuvent être retrouvés chez des femmes nullipares ou des hommes [1].
Chez la femme enceinte, on retrouve entre 66 et 100 % de diastasis au 3e trimestre, suite à l’adaptation normale et nécessaire au grandissement du bébé et donc du ventre de la maman. Nous parlons beaucoup de ce fameux diastasis post-partum et les femmes sont souvent apeurées ou en tout cas peu informées sur les causes et conséquences.
En tant que professionnels de santé, que devons-nous répondre aux femmes ? Et comment objectiver la présence d’un diastasis pathologique ? Comment l’évaluer ? En se basant sur la littérature, tentons donc d’en définir les conditions d’évaluation initiale et discutons de son évolution, des facteurs de risques et des conséquences.