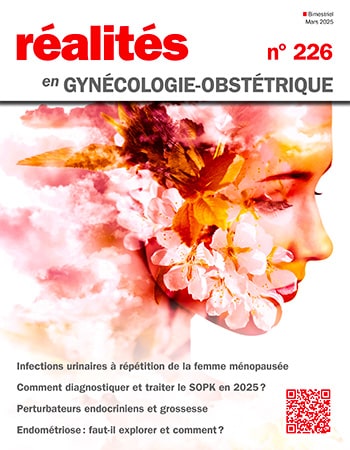Endométriose : faut-il explorer et comment ?
L’endométriose touche environ 10 % des femmes en âge de procréer. Le diagnostic reste complexe : il est basé sur l’interrogatoire, l’examen clinique et l’imagerie, comme l’échographie et l’IRM, mais aucun moyen diagnostic seul n’est suffisant.
Les techniques d’imagerie sont particulièrement utiles pour détecter les formes profondes, bien que des biais existent, notamment pour les formes superficielles.
Des outils récents comme l’analyse des microARNs dans la salive montrent une sensibilité et une spécificité élevées, surpassant même la cœlioscopie diagnostique. Cette avancée pourrait révolutionner la stratégie diagnostique, en réduisant les interventions chirurgicales inutiles et en permettant un diagnostic plus précoce. Un algorithme intégrant ces innovations est proposé pour améliorer la prise en charge globale des patientes.