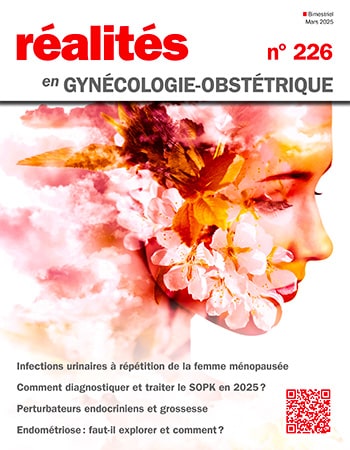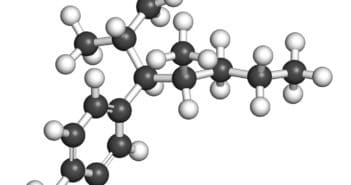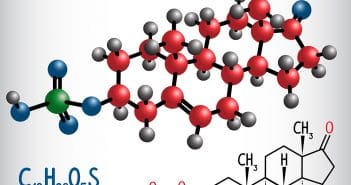Signes d’hyperandrogénie chez la fille : quand explorer et quand traiter ?
L’hyperandrogénie isolée est un symptôme peu fréquent en pédiatrie. Évoquée cliniquement devant un hirsutisme, une acné, une hypertrophie clitoridienne et/ou une accélération de la vitesse de croissance, elle doit être confirmée biologiquement. Une hyperandrogénie chez une fille orientera le diagnostic vers une maladie génétique congénitale non encore diagnostiquée, ou une pathologie acquise des surrénales ou des ovaires.
Quel que soit l’âge de la patiente, l’apparition brutale et/ou évolution rapide des signes cliniques d’hyperandrogénie doit faire évoquer une cause tumorale.
Nous ne discutons pas ici de pilosité pubienne accompagnant un développement des seins dans le cadre d’un début pubertaire central.