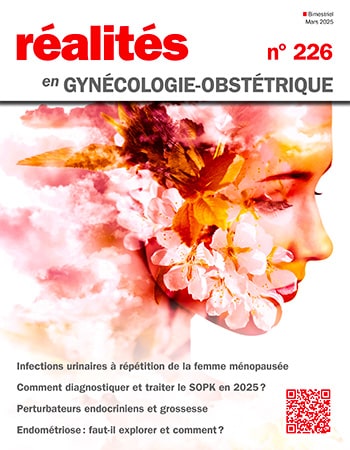Enjeux éthiques du dépistage prénatal de la trisomie 21 à l’heure de l’analyse de l’ADN fœtal libre circulant
Depuis 2013, l’analyse de l’ADN fœtal libre circulant à des fins de dépistage de la trisomie 21 est de plus en plus utilisée, hors de toute stratégie nationale de dépistage. À l’heure où la Haute Autorité de santé (HAS) envisage les modalités d’intégration de cette approche dans la stratégie actuelle, il est essentiel que certains enjeux éthiques en rapport avec le dépistage prénatal non invasif (DPNI) soient envisagés dans le contexte économique contraint qui est le nôtre.
Ce dépistage, plus performant semble-t-il que le dépistage combiné du premier trimestre et répondant à des attentes sociétales légitimes, ne favorise-t-il pas plus encore une sélection des enfants à naître ? Cette question, qui est celle de la finalité de la performance technologique appliquée au champ du dépistage prénatal, nous amènera à examiner le problème central de l’information des professionnels et des patientes, indispensable pour envisager un choix éclairé et autonome.