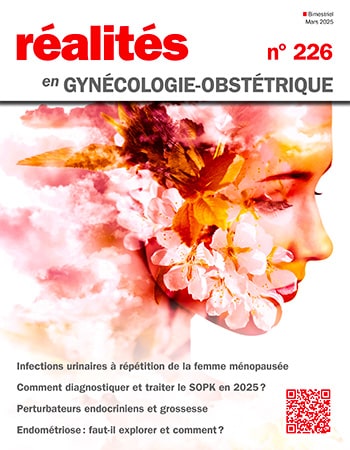Contraception et prédispositions génétiques au risque de cancer du sein ou de l’ovaire
On estime qu’environ 5 à 10 % des cancers du sein sont héréditaires et qu’environ 2 femmes sur 1 000 seraient porteuses d’un variant délétère (dit “mutation”) BRCA.
Les patientes porteuses d’une mutation BRCA présentent un risque très augmenté de cancer du sein ou de l’ovaire en comparaison avec les femmes de la population générale. Or, on sait que les contraceptions hormonales peuvent modifier le risque de présenter un de ces cancers.
En France, il n’existe aucune contre-indication à la prescription de traitements hormonaux chez les patientes porteuses d’une prédisposition génétique au cancer du sein et de l’ovaire, en l’absence d’antécédent personnel, mais il est important de pouvoir discuter des risques et bénéfices induits par ces traitements avec ces patientes souvent inquiètes de modifier leur risque déjà important.