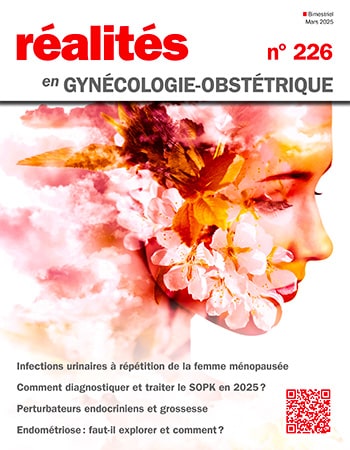Contraception et auto-immunité
Les maladies auto-immunes concernent 10 % de la population avec une majorité de femmes. Il existe un pic de fréquence au moment de la périménopause en lien avec les fluctuations hormonales, car les estrogènes jouent un rôle dans la réponse immunologique. Étant donné leur fréquence et leur âge de survenue, il est essentiel d’informer les femmes sur le type de contraception possible avec leur maladie. Par exemple, la contraception œstroprogestative n’est pas recommandée en cas de connectivite, car elle augmente le risque d’exacerbation de l’auto-immunité ainsi que le risque de maladie thrombo-embolique veineuse. Les microprogestatifs n’ont, eux, pas d’impact sur le risque vasculaire ou métabolique et sont donc utilisés de manière préférentielle chez les patientes lupiques. Enfin, il est possible de prescrire une contraception d’urgence, quelle que soit la maladie auto-immune que présente la patiente.