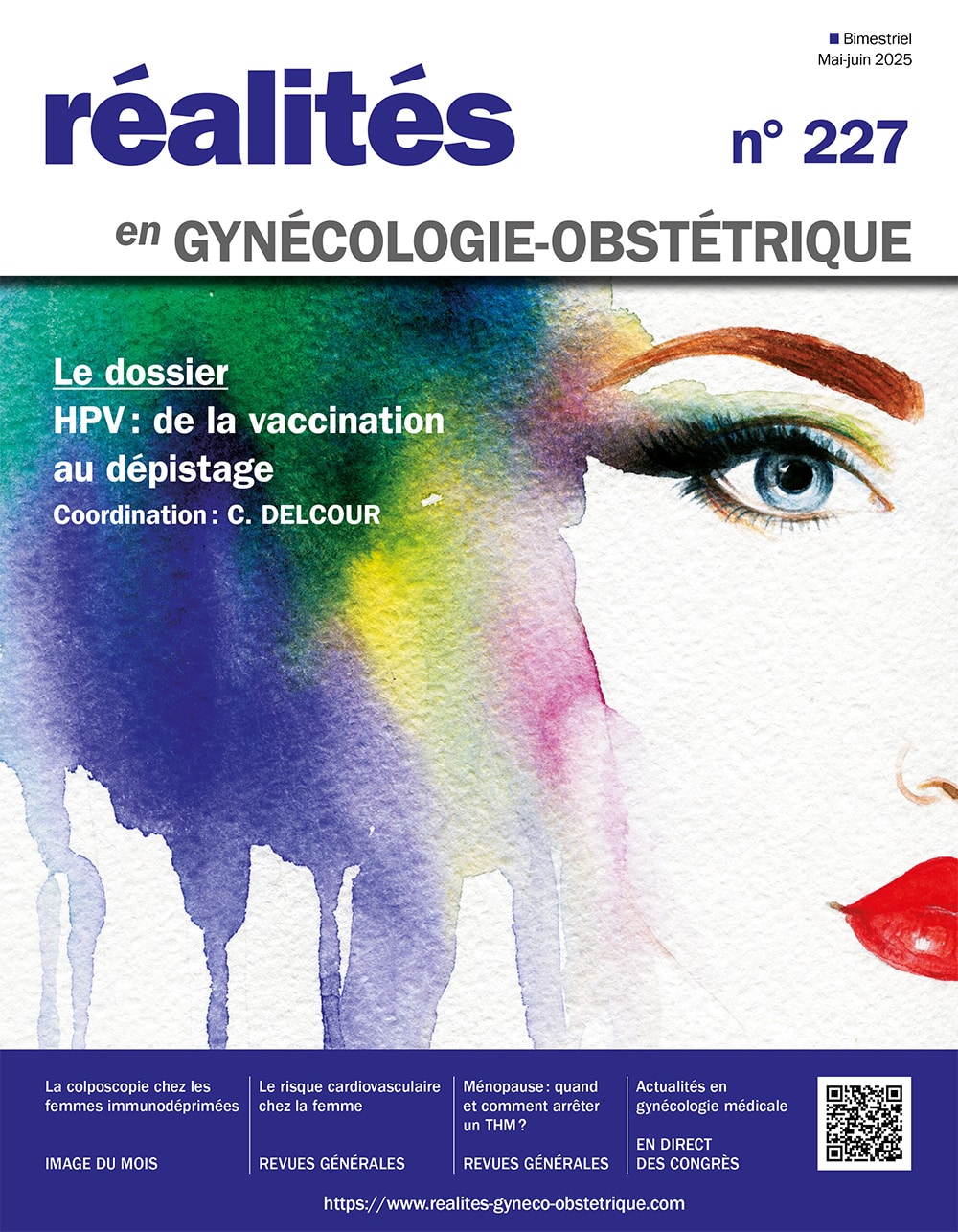Faire un point deux ans après le vote de la dernière loi de bioéthique (2022) permet de soulever de nouvelles interrogations. Dont la question de l’accès aux origines pour les enfants conçus grâce à l’utilisation de gamètes et d’embryons, sujet qui suscite encore nombre de résistances 1. On note en effet, en écoutant les enfants conçus par le biais de cette méthode, qu’à leurs yeux, l’enjeu de la levée de l’anonymat du donneur à leur majorité ne se résume pas seulement à trouver le donneur : ces derniers sont en quête d’un lien informel avec les autres enfants de cet homme (ou de cette femme s’il s’agit d’une donneuse). Ils recherchent des pairs plus qu’un père.
J’avais suivi un patient conçu par IAD avant loi, qui avait pu localiser son géniteur, ce dernier étant d’accord pour le rencontrer. In fine, ce patient a décliné et lui a uniquement demandé qui étaient ses enfants… Il a fini par les rencontrer ! Or, la philosophie de la loi actuelle récuse absolument toute idée de “faire famille” avec les donneurs de gamètes et d’embryons. Les parents ne savent pas combien d’IAD ou de FIV ont réussi (de zéro à une dizaine).
D’ailleurs, certains ont déjà eu recours aux tests ADN, interdits en France, mais facilement accessibles sur Internet.
Ils veulent connaître l’identité du donneur et recherchent aussi d’éventuels demi-frères et sœurs. Selon ces enfants, ce groupe de personnes partageant la même expérience du don crée, le plus souvent, une relation, amicale ou quasi familiale. Apparaît ainsi une famille élargie qu’aucune norme n’impose. Ce qui ajoute une nouvelle touche – la famille choisie – à la palette composite de la famille contemporaine 2.
1 J’ai développé ce point dans mon précédent article de Realités pédiatriques, n° 269 (septembre 2023).
2 La sociologue Dominique Mehl a longuement développé ce point dans Dialogue n° 242, 2023, La famille élective, p. 25-41.
Les difficultés de la mise en route de la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (Capadd), organisme ad hoc créé pour faciliter les demandes de rencontre entre donneurs et receveurs, illustrent les résistances institutionnelles fondées sur le lourd protocole bureaucratique qui prévaut et qui est couplé avec l’interdiction des tests ADN. En septembre 2023, la Commission avait reçu 434 demandes d’accès aux données. Elle a identifié 101 donneurs, 73 ont été contactés.
À cette date, une seule personne avait retrouvé son donneur 3.[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire