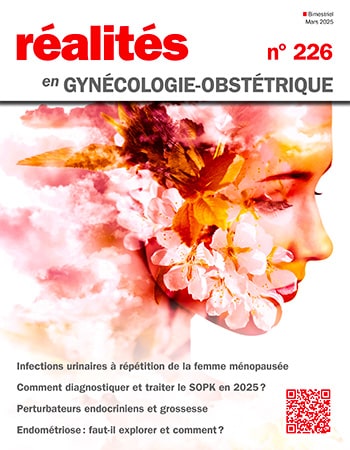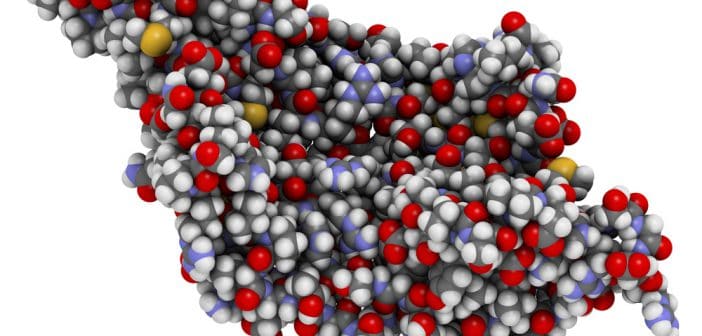La prééclampsie est une affection spécifique de la grossesse dont la physiopathologie est complexe. Sa prévalence est estimée entre 2 et 8 % des grossesses dans le monde [1]. En France, nous ne disposons pas de chiffre précis sur ce point, mais elle est probablement proche de 2 à 3 %. Surtout, la prééclampsie constitue un enjeu majeur de santé publique car elle est la première cause de morbi-mortalité fœtale et maternelle réunies.
Des évolutions récentes ont conduit à réviser la définition de la prééclampsie. Si la survenue après 20 SA d’une HTA > 140/90 mmHg et d’une protéinurie > 300 mg/24 h demeure suffisante pour poser le diagnostic, cette définition stricte ne permet pas pour autant de couvrir l’ensemble du spectre des manifestations clinico-biologiques de la pathologie. Désormais, selon les sociétés savantes américaines, la présence d’une protéinurie anormale n’est plus indispensable pour retenir le diagnostic s’il existe d’autres signes évocateurs de l’affection (tableau I). Cette nouvelle définition permet de prendre en compte le pléïomorphisme de la maladie et souligne surtout les difficultés diagnostiques qui peuvent être rencontrées dans la pratique clinique.
Les 15 dernières années ont vu émerger le rôle des facteurs pro- et anti-angiogéniques, en particulier le Placental Growth Factor (PlGF) et son récepteur sFlt-1, dans la pathogenèse et l’identification de la prééclampsie. L’objectif de cet article est de synthétiser les connaissances actuelles élémentaires sur le potentiel de ces facteurs comme biomarqueurs diagnostiques, pronostiques et prédictifs de la prééclampsie.
Physiopathologie
Le placenta est amarré à la décidue par les villosités d’ancrage. Dans des conditions normales, les cellules cytotrophoblastiques de ces villosités envahissent la décidue. En arrivant au contact des artères spiralées déciduales, les cellules trophoblastiques vont induire des modifications locales conduisant à une baisse du tonus vasculaire de ces artères et favoriser l’afflux sanguin dans la chambre intervilleuse. Deux mécanismes principaux président à cette vasodilatation [2] :
>>>[...]
Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.
Vous êtes abonné(e)
IDENTIFIEZ-VOUS
Pas encore abonné(e)
INSCRIVEZ-VOUS
Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales
S'inscrire